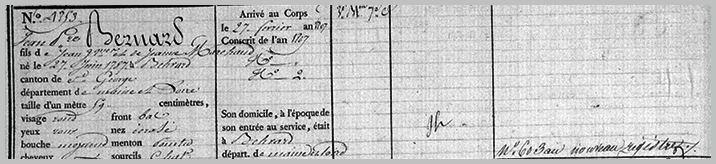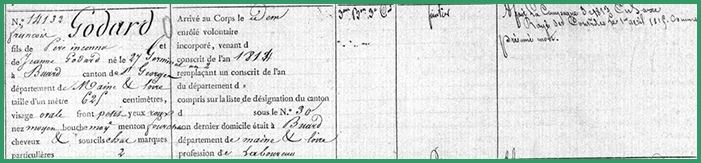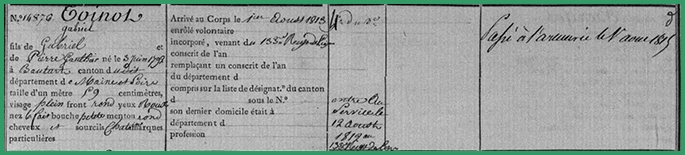histoire
- Accueil
- ORIGINES
- HISTOIRE
- BATI- ACTIVITÉS
- EGLISE
- PELERINAGE
- Maison Diocésaine
- A propos
DAMES et SEIGNEURS de BÉHUARD
MARTEL Geoffroy dit Le Barbu – comte d'Anjou – 1070
BUHUARDT Le BRETON et son épouse Anna, propriétaire de Béhuard
FOLET Gérard – 1090
FOULQUE Le RÉCHIN – 1116
FOULQUE, fils du précédent - 1130
GARREAU Mathieu, chevalier - 1170
D'ARAGON Yolande, veuve du Duc Louis II d'Anjou – 1431
DE BRIE Jean, seigneur de Serrant – 1450
DE BRIE Ponthuis, comte de Serrant, fils du précédent – 1481
DE BRIE Péan, comte de Serrant - 1540
DE BRIE Charles, seigneur de Serrant – 1563
LE BIGOT – BAUTRU Marthe, dame et comtesse de Serrant – 1650
DE BAUTRU Guillaume, comte de Serrant – 1658
WALSH François Jacques, comte de Serrant – 1749-1782
Histoire
Si l'histoire de l'île de Béhuard ne présente pas, comme celle des grandes cités, de palpitantes péripéties où les drames se succèdent, si son sol n'a jamais été arrosé de sang humain dans des guerres fratricides, enfin si des hommes illustres n'y ont point reçu la vie, elle n'en est pas moins célèbre par la beauté de son site, l'un des plus enchanteurs des bords de la Loire et par les souvenirs qu'y laissa le cauteleux Louis XI. Souvenirs qui se rattachent à une petite madone sur laquelle, depuis, s'est fixé le regard des populations d'alentour, qui, à l'exemple du roi, se sont rendues vers elle maintes fois en pèlerinage. Le gothique édifice qui abrite la statuette vénérée est bien digne d'intérêt, lui aussi, par l'originalité de sa situation et les richesses archéologiques qu'il renferme. Enfin, rien dans Béhuard n'attriste l'imagination, tout y respire, au contraire, un suave parfum de bonheur et de paix, que sont heureux de venir savourer les touristes auxquels sont destinées les pages qui suivent.
L'île de BEHUARD, l'une des plus ravissantes de la Loire, doit son nom au preux chevalier breton Buhuardus, qui la possédait au Xe siècle.
Cette île se distingue entre toutes celles du fleuve par une roche de quartz siliceux, qui domine les arbres groupés autour d'elle.
Sortie du sein des eaux sans doute dans le même cataclysme que les berges volcaniques qui bordent çà et là les deux rives de la Loire vers le confluent de la Maine, cette roche a dû servir de point d'attache aux sables, qui, avec le temps, ont formé le banc de plus d'une lieue de long, qui constitue maintenant le sol de l'île et que fécondent tous les ans les détritus apportés par les inondations.
Malgré le caractère exceptionnel de cette terre isolée, avec son roc entouré d'une luxuriante végétation, il est permis de croire que les peuples primitifs qui l'auront vue disparaître chaque hiver sous les eaux ou battue violemment par les flots du fleuve en courroux, n'auront point été tentés de lui demander une généreuse hospitalité. Aussi doit-on rejeter les fables merveilleuses que les légendaires ont brodées sur les origines de Béhuard, comme étant autant de fictions inventées dans une contrée qui fut le dernier boulevard du druidisme en Anjou. Car c'est dans le pays des Mauges, voisin de Béhuard, qu'ont pris naissance une foule de croyances dont l'esprit du peuple n'est point encore complétement débarrassé.
Le culte de la nature, et en particulier celui des pierres et des eaux, a été pendant bien des siècles le culte favori des Galls, qui furent les premiers habitants connus du pays ; aussi n'est-il point étonnant que la roche de Béhuard ait reçu en passant les hommages de quelques antiques nautonniers, ce qui lui aura valu plus tard les honneurs d'une légende. Un mauvais génie, nommé Behu, était le héros de la prosopopée populaire ; il se tenait constamment sur la roche, armé d'un immense fîlet qu'il jetait sur les bateaux pour les amener à lui et forcer les bateliers à lui payer un tribut. Quand ceux-ci refusaient, Behu soulevait contre eux le fleuve qui les précipitait dans quelque abîme. Cette fiction devait avoir pour origine les nombreux naufrages dont la Loire était le théâtre à une époque où la navigation était encore dans l'enfance.
Voulant sans doute christianiser la légende de Behu, certains esprits torturèrent le texte de la légende de Saint Maurille pour doter ridiculement l'île de Béhuard d'un temple ou bocage sacré, dont Rochefort, d'après le récit de l'hagiographe, était bien plus l'emplacement. Toutefois, ils n'ont pas craint d'avancer que l'illustre thaumaturge Maurille, ému du fanatisme des peuples d'alentour envers l'idole de Behu, vénérée par eux sur le roc de l'île, implora l'assistance de Dieu pour détruire ce sanctuaire du polythéisme ; aussitôt la foudre tomba sur le simulacre et le réduisit en cendres. Les témoins, émerveillés par ce miracle, se seraient, parait-il, écriés : Behu ard (Behu brûlé) , d'où serait venu à l'île son nom de BÉHUARD. Il est inutîle d'ajouter que tout cela n'est que pure fable et que l'origine du nom et de l'histoire de l'île ne remonte qu'au temps de Geoffroy-Martel, comte d'Anjou, qui succéda à son père Foulques Nerra en 1040.
Ce fut ce prince belliqueux qui donna, à titre de fief, à son compagnon d'armes, le chevalier Bu-huardus, deux ou trois îles de la Loire, que l'on dit s'être réunies par la suite des temps, pour former celle qui porte encore son nom. Dans la principale de ces îles, il fit édifier sur le roc un manoir avec une chapelle, dont il confia le service divin à un moine de l'abbaye bénédictine de Saint-Nicolas d'Angers ; près de cette demeure, il établit également pour son alimentation et celle de ses gens des viviers, une écluse et un moulin. Enfin, les deux autres îles couvertes de frais pâturages et de riants : les bosquets lui servirent à engraisser des troupeaux. C'est dans cette terre isolée du continent et éloignée du bruit du monde, que, brisé par les fatigues de la guerre, le vieux héros breton passa, dans une douce quiétude, l'âme remplie de l'amour de son Dieu, les dernières années de son existence en compagnie de son chapelain : faveur qu'il avait obtenue en laissant à l'abbaye la moitié de son revenu pendant sa vie.
Buhuardus avait emporté, dans la retraite, le souvenir des bienfaits de Geoffroy Martel ; la mort de ce noble comte, survenue en 1061, ne fit qu'augmenter en lui ses sentiments de reconnaissance et lui inspirer de sérieuses réflexions. Pressentant alors que sa fin était prochaine, il résolut de mettre ses affaires en ordre pour le grand voyage de l'éternité. Dans ce but, il se recueillit, demanda à Dieu son assistance, et, sous l'influence de l'inspiration divine, son regard se porta instinctivement vers Saint-Nicolas d'Angers où son cher seigneur et maître reposait sous une humble tombe, le corps enseveli dans le grossier costume d'un frère lais. Croyant sans doute rendre au comte les îles qu'il tenait de sa libéralité, il les légua aux moines, qui, eux aussi, avaient été ses protégés. Foulques Réchia, neveu et successeur de Geoffroy- Martel, accorda son consentement à ce legs pieux, qui fut également approuvé par une charte particulière de Anna, épouse de Buhuardus.
Lorsque les bénédictins de Saint-Nicolas furent entrés en jouissance des îles de Buhuardus, dont le nom en se francisant se transforma de Buhuard en Béhuard, ils s'efforcèrent d'en améliorer la condition. Le chevalier breton leur avait laissé l'intégrité de son fief ; mais, tout autour, des seigneurs riverains exerçaient des droits incommodes : avec le temps les moines les firent tourner à leur avantage. Il y avait surtout un duit ou bras de rivière, où était perçu, au profit du comte, un octroi qui paraissait si naturellement appartenir à Béhuard que les pieux cénobites ne cessaient de faire des efforts pour s'en rendre propriétaires. Selon les apparences, ce duit était le canal qui sépare îlle de Béhuard de l'île de Saint-Jean-de-la-Croix : passage important, parce qu'il était la voie pour entrer dans le bassin de la Maine, de tout le parage entre Brissac et Denée. L'importance de ce duit rendait encore plus difficîle sa cession ; toutefois, les bénédictins ne se découragèrent pas et ils attendirent avec confiance les effets du temps.
Vers l'an 1070, le monastère de Saint-Nicolas était gouverné par le moine Hamo, qui avait hérité de la crosse abbatiale à la mort d'Arraudus. Doué d'une subtîle intelligence, cet Hamo ou Hamon avait su capter l'amitié du prévôt d'Angers, Gérard Folet, auquel il s'était, plus d'une fois, doucement ouvert à l'égard des convoitises de son couvent pour le duit de Béhuard. Malheureusement, le digne prévôt ne pouvait disposer à son gré des biens du comte d'Anjou ; cependant, voulant répondre de son mieux aux épanchements de son ami, il transmit à Foulques-Réchin la requête que l'abbé lui avait maintes fois adressée ; mais le comte Foulques, capricieux dans ses dons, ne voulut jamais obtempérer à la demande du prévôt ; pour le vaincre, il ne fallut rien moins qu'un miracle.
C'était en 1090, Foulques, dont le caractère grincheux lui avait valu le surnom de Réchin, était en guerre avec le noble et chevaleresque Hélie, seigneur de La Flèche. L'un et l'autre étaient de redoutables champions, habîles dans le métier des armes et prodigues du sang de leurs vassaux. Après avoir vainement essayé d'enlever d'assaut la place forte de La Flèche, le comte d'Anjou résolut de la prendre par la famine. Pendant le blocus, qui fut long, il reçut un coup de pied de cheval dont il eut la cuisse cassée. Comme il ne pouvait plus diriger par lui-même les opérations du siège, et qu'il manquait sans doute dans son camp des objets nécessaires pour la guérison de sa fracture, il résolut de se faire transporter à Angers par la voie douce et paisible que lui offrait le cours du Loir. On le déposa donc sur un bateau. Le Loir est une rivière profonde et navigable en tout temps. L'embarcation de Foulques eut bientôt dépassé Gré, Durtal, Montreuil et Seiches ; mais devant Corzé, elle éprouva un terrible moment d'arrêt. Il y avait en cet endroit un barrage qui n'était ouvert que par une porte pratiquée entre le port de la ville et une île de la rivière, et le courant, à cause de la résistance qu'il éprouvait sur les autres points, se précipitait là avec une violente furie.
Or il advint qu'un des mariniers, qui conduisait le comte d'Anjou, lâcha malencontreusement une perche ou une gaffe, qui s'engagea au travers de la porte, entre les poteaux dont ses montants étaient formés. Le bateau, repoussé par cet obstacle, commença à pirouetter, si bien que l'équipage perdit la tête ; et le comte, avec les seigneurs de sa suite, allait infailliblement périr, lorsque Gérard Folet, qui était du voyage, eut la présence d'esprit de briser la perche. Grâce à cet acte de sang-froid, le passage s'effectua. Foulques n'attendit pas d'être à Angers pour reconnaître un si grand service ; il se souvint de la demande que lui avait adressée plusieurs fois son prévôt, prit une baguette de saule et, là lui la mettant dans la main, lui déclara par ce symbole qu'il l'investissait de la propriété du duit de Béhuard.
Aucun présent ne pouvait être plus agréable à Gérard Folet, qui s'empressa de faire participer les moines de Saint-Nicolas d'Angers de la libéralité du comte. Pour des raisons restées inconnues, il ne céda pas de prime-abord le duit comme il l'avait reçu ; il commença par livrer au monastère la moitié des profits du passage ; plus tard, il abandonna l'autre moitié, moyennant une faible somme d'argent, c'est-à-dire en vertu d'une vente de charité, faite sans doute pour empêcher ses héritiers de revenir sur la cession. La somme, pour laquelle Gérard Folet céda la totalité de ses droits sur la donation qu'il avait reçue du comte d'Anjou, fut de 6 livres, ce qui représentait environ 600 francs de notre monnaie. Les Bénédictins ajoutèrent à cette somme 5 sous, pour que le bâtard du prévôt accordât son agrément au marché conclu par son père.
La possession du duit de Béhuard n'était point encore, parait-il, l'accomplissement de tous les rêves des moines ; il restait, autour de leurs îles, d'autres bras de rivières dont l'eau ne leur appartenait pas, ce qui leur suscitait de nombreux ennuis. En bon prince, Foulques-le-Jeune, fils et successeur de Foulques-Réchin, à la requête de son médecin, le docte Jean, qui avait endossé le froc monacal dans l'abbaye de Saint-Nicolas, concéda aux religieux un des bras de la rive droite de la Loire, pour augmenter la retenue qui faisait tourner leurs moulins. En 1135, dit le savant M. Quicherat, ils en reçurent un autre de la libéralité de Geoffroy Plantagenet, pour y faire une écluse, des moulins et des parcs à poisson. Cette dernière concession comprenait non-seulement la propriété de l'eau, mais encore celle de plusieurs ilots situés en face de Savennières : ce sont par conséquent les bancs qui ont été reliés au continent depuis les travaux du chemin de fer. L'investiture en fut donnée d'une manière tout à fait solennelle, par l'envoi sur les lieux du prévôt d'Angers, nommé Pépin de Tours, avec l'abbé de Saint-Nicolas et quantité d'autres personnages éminents. La compagnie s'étant arrêtée sous la Roche-au-Moine, le prévôt s'avança vers une troupe de charpentiers, qui se tenaient là tout prêts à commencer les travaux de pilotis, et, avec leur aide, il enfonça le premier poteau, en prononçant la formule par laquelle cette eau et cette terre devenaient désormais l'eau et la terre de Saint-Nicolas.
La série des donations se termine par celle d'un dernier îlot, dont un chevalier du nom de Mathieu Garreau, Malthceus Corelli, fit aumône en 1170 , de sorte que la propriété était définitivement constituée lorsque les moines en prirent confirmation, à l'avènement de Richard Cœur-de-Lion , le 14 novembre 1189.
Maintenant, il serait impossible d'indiquer avec précision où étaient les îlots, les boires, les écluses et les moulins, cités en si grand nombre dans les chartes de l'abbaye de Saint-Nicolas, du onzième au quatorzième siècle, car dès le dix-septième siècle, on avait déjà perdu, depuis longtemps, le souvenir de l'emplacement des moulins et des écluses qui étaient entièrement détruits ainsi que des boires qui avaient disparu lorsque les îlots s'étaient réunis au continent ou groupés pour former de grandes îles. On ignore même où était la petite chapelle de l'écluse citée dans la dotation de Mathieu Garreau. Seule, la chapelle bâtie sur le pic du roc dans l'île de Béhuard a survécu aux ravages des siècles. Dès le XIe siècle, elle était placée sous le vocable de Notre-Dame, ainsi que l'atteste un récit de Dom Huynes, dans la vie du vénérable Sigo, abbé de Saint-Florent de Saumur.
Ce moine, qui était un des plus beaux esprits de son temps, avait été élève, puis professeur à l'école célèbre de Marmoutier-lés-Tours. Un jour qu'il descendait le cours de la Loire depuis Saumur jusqu'à son monastère du Montglonne , il arriva, dit la légende, « au lieu qui s'appelle Notre-Dame de Béhuard », et comme la nuit le surprit dans ce parage, il aborda sur une petite île, où ses serviteurs ne purent lui offrir pour souper que du poisson apporté par un pécheur de Béhuard. L'abbé, après avoir largement rétribué ce pourvoyeur inattendu, voulut qu'il mangeât avec ses gens. Mais, soit à cause de l'obscurité de la nuit qui était alors très-grande ou des libations trop abondantes qu'il avait pu faire, le malheureux pécheur, en rentrant chez lui, heurta si rudement contre un écueil que son bateau sombra. Se voyant aux prises avec la mort, il jeta des cris de détresse si extraordinaires que l'abbé et ses gens s'empressèrent d'aller à son secours ; mais comme la nuit était profonde et que les cris cessèrent, ils renoncèrent à le chercher, le croyant noyé. Heureusement, il n'en était rien ; l'infortuné pécheur, grâce à une hallucination qu'il avait eue, s'était mis en lieu de sûreté. Croyant voir l'abbé Sigo qui étendait sur lui son manteau et qui lui tendait son bâton, il avait eu la force de s'accrocher au palis d'une écluse. C'est là, le lendemain matin, qu'il fut trouvé vivant et qu'il raconta ses impressions de la nuit.
Ce récit permet d'inférer, selon la judicieuse observation de M. Quicherat, que si la chapelle du chevalier Buhuardus était déjà sous l'invocation de la Vierge, elle n'était pas encore un lieu de dévotion renommé dans le pays ; car, autrement, l'imagination du pécheur lui aurait fait attribuer son salut de préférence à la protectrice de fîle, bien plutôt qu'à celle d'un simple abbé qu'il voyait pour la première fois. Ainsi, on ne peut faire remonter au XIe siècle le culte particulier établi plus tard en l'honneur de la madone de Béhuard. Les plus anciennes traces qui restent de ce culte sont quelques relations de miracles recueillies par l'ancien curé de Sainte-Croix d'Angers, Joseph Grandet.
Source : Histoire de Notre Dame par Parrot
![]()
BUHARDT LE BRETON
Cartulaire Saint-Nicolas
Notice -XIII de 1060, (peu après la mort de Geoffroy-Martel) Buhard-le-Breton, mîles, donne à Saint-Nicolas deux îles sur la Loire dont la Roche Béhuard et trois bordages de terres sises à la Bigotière (paroisse de Rochefort-sur-Loire). Le comte Geoffroy-Le-Barbu autorise cette donation.
Notice XIV- entre 1076-1080, Girard Folet, prévôt d'Angers, qui avait sauvé la vie de Foulque-le-Réchin, blessé grièvement à la jambe à la suite d'un accident de cheval au siège de la Flèche et se faisant transporter par eau à Angers, faillit sombrer sur le Loir à Corzé, reçoit en récompense le ductum aquae à la Roche Béhuard et le redonne à Saint-Nicolas moyennant six livres.
Notice CCLXIII- entre 1109-1116, Foulque V, alors qu'il avait été blessé et avait échappé à un naufrage sur le Loir, donne à Saint-Nicolas l'eau de la Loire qu'il possède en propre à la Roche Béhuard, pour améliorer le canal de leurs moulins, pour la subsistance des moines et l'amour de Jean, médecin et moine de Saint-Nicolas.
Notice -CCCV- de 1135, Geoffroy Plantagenêt, à la prière de l'abbé Jean et pour le repos de son âme, de celle de sa femme, l'impératrice Mathilde et de ses fils, donne à Saint-Nicolas l'eau de la Loire à la Roche Béhuard, sous l'ancienne écluse des moines avec les îles, le droit d'établir une écluse, des moulins et des pêcheries.
Notice CCCXVII- du 9 septembre 1170, Matthieu Garell, mîles, donne à Saint-Nicolas une petite île de la Loire sise à la Roche Béhuard près de la chapelle de l'écluse de Saint-Nicolas pour le repos de l'âme de son frère et de son père enterrés dans le cimetière de Saint-Nicolas et pour son salut et celui de sa famille.
C'est une rareté dans les textes médiévaux d'avoir un écrit aussi long et presqu'aussi détaillé sur un lieu. C'est donc avec grand intérêt que vous trouverez ci-après sa traduction approchée et le commentaire qu'inspire un tel document tiré du cartulaire de Saint-Nicolas d'Angers, reconstitué par Yvonne Labande-Mailfert dans sa thèse de l'École des Chartes en 1931 (non publiée).
" Moi, Buhardt le Breton, dans la grande douleur que me cause le décès de mon seigneur Geoffroy-Martel, comte d'Anjou, arriva à la requête au seigneur d'un remède pour le salut de nos âmes, interrompit pour moi ses conseils bons, pieux et dignes d'éloges mais pour l'âme de ce comte, pour toutes les armes de ses prédécesseurs et successeurs et pour mon âme et celle de mon épouse, et de mes parents, je donne à Dieu et à Saint-Nicolas dans le chapitre ou le comte nommé Geoffroy a été inhumé en son habit de moine, par choix pour la vie des moines qui y servent Dieu. Après avoir pris peu de conseils, j'ai donné à Dieu et à Saint-Nicolas ce que j'avais en Loire, à savoir deux îles, une dans laquelle se trouvent les roches, ma domus et ma chapelle, l'autre où sont mes bois et mes pâturages. Je donne aussi mes viviers de Loire, mon écluse (exhaure), mon bief et un moulin qui y ont été édifiés et qui pourront l'être. Je donne aussi trois bordages de terres à la Bigottière, diminué du droit de viager pour ma vie durant et à condition que le moine Gérard qui vit avec moi dans ma roche en fasse la surveillance. Tout ce qui est dit ci-dessus est vrai et forme l'intégralité de mes dons à Saint-Nicolas. À mon bénéfice, chacun de mes anniversaires soit célébrés chaque année par les moines, les frères et les laïcs de leur obédience. »
A cette donation sont témoins, Joannes, Geraldus, Berengarius, Raginaldus, avec l'autorisation du comte Geoffroy le Barbu, qui est en ce temps comte d'Anjou, de son frère Foulque, son successeur potentiel.
Ici, le comte Barbu apposa sa signature en croix sous le regard de Goffredo, Foulque et Foucher, ses frères, Geoffroy fils de Foucher, Morin, Algardis fils d'Hugues Normand, Radulfe de Varennes, Marguerio, Hugues de Montigné, Guillaume Clerc.
Ici fit une croix, Foulque comte junior en témoignent Hugues de Mayenne, Aimeric de Chanone, Rotald le Breton, Israël Helinanno son neveu, Guillaume Radulphe, Hubert de Rivière, Jean fils de Seibran, Ulrique chanoine, Attone, Mabille épouse de Jean de Chinon.
Fit une croix Juliana épouse du comte Geoffroy Le Barbu.
Daté de 1060, peu après le 14 novembre, date du décès de Geoffroy Martel selon Yvonne Labande-Mailfert, (Cartulaire de Saint-Nicolas, thèse manuscrite de l'université de Poitiers, 1931, notice XIII). L'original du cartulaire est perdu, la copie originale aussi, Il en existe une copie du XVIe siècle aux ADML, H 397-22, Dom Housseau (analyse seulement) du XVIIIe siècle, collection Touraine, vol. XIII f' 20, n° 9511 et quelques autres analyses. Voir Louis Halphen, Le comté d'Anjou au XIe siècle, dans son catalogue d'acte 158 et Olivier Guillot, Le comte d'Anjou et son entourage, Paris, page 749, C 221 et 272, C 437.
Analyse de ce texte
Pour analyser ce texte, il faut d'abord le dater, car il a été écrit au moins en deux temps.
La première signature est celle de Geoffroy Le Barbu. Il est comte d'Anjou jusqu'en 1067, date à laquelle son frère Foulque Le Réchin le remplace à la suite d'une guerre et d'une sédition populaire qui va permettre à Geoffroy Le Barbu de reprendre temporairement son comté. Il est définitivement vaincu et fait prisonnier par son frère Foulque le Réchin en 1068. Le second paragraphe montre Foulque Le Réchin signant et confirmant les dons de Buhardt.
Les témoins aux deux paragraphes sont rarement cités dans d'autres actes, mais ils sont actifs entre 1060 et 1070 et ne permettent pas de dater avec certitude. Il se pose une question au sujet du témoin Israël Helianno. C'est un nom rare, et contrairement aux autres personnages, il apparaît dans plusieurs notices. Il serait un petit-neveu du Breton Clamarhoc et neveu de Rotald le Breton d'après cette notice. S'il apparaît comme tel vers 1123, il est indiqué comme un membre de la famille comtale en 1068 dans la notice et dans ce texte comme neveu de Rotald. Il apparaît une impossibilité chronologique que la relative obscurité de la vie de ce témoin ne permet pas de lever, mais de douter de son éventuelle implication, autrement que comme témoin de convenance venant à l'appui de la crédibilité de cet acte ? Par ailleurs, comme il ne s'agit pas d'un acte authentique, mais d'une copie, Dom Housseau, nous savons que ce copieur est généralement fidèle dans le corps du texte, mais que la liste des témoins n'est pas toujours respectée avec précision. Foulque apparaît bien comme successeur de Geoffroy dans le premier paragraphe consacré aux témoins, mais dans le troisième, il est indiqué comme Comte. La première partie aurait été écrite entre 1060 et 1067 ou 1068, mais sans doute au début de cette période puisque Buhardt se dit en grande douleur après la mort de Geoffroy-Martel. On peut considérer que la date serait de la fin de l'année 1060 en style angevin, c'est-à-dire avant Pâques 1061 en nouveau style.
La confirmation par Foulque ne peut guère intervenir avant 1069, tant la situation successorale est incertaine entre 1067 et 1068, date de sa victoire définitive à Brissac en avril 1068 en style angevin, donc avant Pâques 1069.
C'est avec une certaine incertitude que l'on arrive à formuler quelque datation. La signature de Juliana, seconde épouse de Geoffroy Le Barbu, n'est pas une aide, car elle survit à la déchéance de son époux et meurt à une date indéterminée.
Authenticité ?
Cette présentation inhabituelle de l'acte fait peser un doute sur son authenticité.
L'environnement de ce texte : mort de Geoffroy Martel et succession difficîle à cause de l'absence d'héritiers directs, pourrait expliquer cette présentation, mais la perte de l'original, de l'aveu même d'Olivier Guillot, fait légitimement douter de son authenticité, tout au moins de la date à laquelle il aurait été écrit. Il n'est pas inhabituel de voir les moines faire des « faux-vrais » pour conforter l'existence de dons qui n'ont pas été correctement écrits. C'est même, selon Dominique Barthélémy, une des bases des dires lors de contentieux ultérieurs.
La localisation
Telle qu'elle est décrite dans la notice, elle s'adapte tout à fait aux îles de Béhuard à cette époque.
L'île actuelle ayant été fractionnée par le cours de la Loire, il y a lieu de refuser la localisation proposée en 1931 par Yvonne Labande-Mailfert qui retenait la Roche-aux-Moines. Bien entendu, le relief de ce toponyme est tout à fait étranger à une île, quel que soit la date de l'événement. La « roche » de Buhardt existe bien sur l'île et on peut imaginer tout à fait que la domus puisse avoir été établie à proximité de ce qui en faisait une motte naturelle. Le toponyme La Bigottière est présent tant sur la commune actuelle de Rochefort que sur celle de Savennières. Mais c'est une appellation courante et la proximité de l'une ou de l'autre avec les îles donne un sens à cette donation. Quant aux viviers, ils sont généralement, en ce XIe siècle, inclus dans le lit mineur du fleuve. C'est un enclos entouré de murs de pierre sèche, recouvrable par crue et dont l'exhaure est alors appelée « écluse ». C'est là que sont posés les fîlets pour la pêche et éventuellement la sortie pour les bateaux. Les moines de Saint-Nicolas attachent une importance particulière au contrôle de l'eau. C'est non seulement un lieu de pêche rémunérateur, mais aussi un justificatif au péage. Ce don revêt une importance significative, d'autant que le texte prévoit l'extension de moulins utilisant sans doute le courant (moulins sur bateaux plus probables que moulins pendus). La qualité du don et son importance économique justifieraient aussi bien la présence de témoins prestigieux que la fabrication d'un « faux » plus ou moins vrai.
Il convient de souligner l'intérêt particulier apporté par les moines de Saint-Nicolas aux aménagements de rivières. Non seulement ils se font attribuer, lors de la création de l'abbaye, le Brionneau qui débouche dans l'actuel étang Saint-Nicolas, mais encore, complétant directement le don présumé de Buhardt, Foulque V dit de Jérusalem donne l'eau qu'il possède à Béhuard pour améliorer leur canal et leurs moulins, pour la subsistance des moines et pour l'amour de Jean, médecin, et moine de Saint-Nicolas. Cette donation contredit en partie celle de Geoffroy-Martel aux chanoines de Saint-Laud et sera à l'origine de nombreux contentieux.
Qui est ce Buhardt
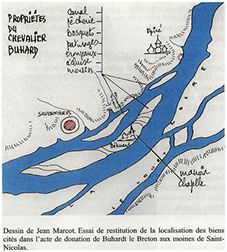 Qui apparaît dans ce texte, mais qui n'a pas d'autres interventions dans les textes des Cartulaires angevins ? Son anthroponyme est assurément d'origine germanique. Ce n'est pas rare de trouver des noms rappelant une origine franque, vraie ou fausse, dans l'entourage Comtal. Ils peuvent être aussi bien des milites, véritables mercenaires qui prêtent leur force et leur qualité guerrière au comte. Il faut se rappeler qu'il n'entretient pas d'armée régulière, mais fait appel soit à l'Ost, service rendu par les vassaux, obligatoire mais limité dans le temps, soit à des mercenaires payés. Ce sera l'une des forces du comte-roi Henri II de lever, grâce à ses revenus, des armées de mercenaires, plus fidèles et plus constants que les vassaux en Ost. Il est vraisemblable que Buhard ait été un mîles, quoique le texte ne l'indique pas. Mais il s'agit d'une copie tardive, faite probablement en un temps où le terme de mîles a été oublié et remplacé improprement par chevalier. On peut citer dans l'entourage du comte des personnages comme Robert le Bourguignon, proche des Capétiens et fortement possessionné en Anjou, ou plus ancien, Renaud-le-Thuringien dont les noms indiquent l'origine germanique. Ce dernier possède aux alentours de l'an mil de vastes domaines dans les Mauges. Il ne faut pas croire que l'immigration, notamment des puissants, ait été absente de ces siècles. Elle est de plus favorisée par les liaisons hypergamiques entre les familles puissantes, comme en témoigne la politique menée par les comtes d'Anjou en la matière. La dernière épouse de Geoffroy-Martel n'est-elle pas Adèle la Teutonique. Il n'est pas impensable qu'elle fût accompagnée d'une suite germanique.
Qui apparaît dans ce texte, mais qui n'a pas d'autres interventions dans les textes des Cartulaires angevins ? Son anthroponyme est assurément d'origine germanique. Ce n'est pas rare de trouver des noms rappelant une origine franque, vraie ou fausse, dans l'entourage Comtal. Ils peuvent être aussi bien des milites, véritables mercenaires qui prêtent leur force et leur qualité guerrière au comte. Il faut se rappeler qu'il n'entretient pas d'armée régulière, mais fait appel soit à l'Ost, service rendu par les vassaux, obligatoire mais limité dans le temps, soit à des mercenaires payés. Ce sera l'une des forces du comte-roi Henri II de lever, grâce à ses revenus, des armées de mercenaires, plus fidèles et plus constants que les vassaux en Ost. Il est vraisemblable que Buhard ait été un mîles, quoique le texte ne l'indique pas. Mais il s'agit d'une copie tardive, faite probablement en un temps où le terme de mîles a été oublié et remplacé improprement par chevalier. On peut citer dans l'entourage du comte des personnages comme Robert le Bourguignon, proche des Capétiens et fortement possessionné en Anjou, ou plus ancien, Renaud-le-Thuringien dont les noms indiquent l'origine germanique. Ce dernier possède aux alentours de l'an mil de vastes domaines dans les Mauges. Il ne faut pas croire que l'immigration, notamment des puissants, ait été absente de ces siècles. Elle est de plus favorisée par les liaisons hypergamiques entre les familles puissantes, comme en témoigne la politique menée par les comtes d'Anjou en la matière. La dernière épouse de Geoffroy-Martel n'est-elle pas Adèle la Teutonique. Il n'est pas impensable qu'elle fût accompagnée d'une suite germanique.
Par contre, la précision de « breton » est plus surprenante et l'on ne peut qu'émettre l'hypothèse que ce Buhardt ait été au service de Geoffroy-Martel lors de ses guerres dans l'Ouest, comme vers Craon et le sud de la Normandie, territoires dont la possession n'est pas très nettement rattachée à un comté.
![]()
Gérard : Le moine.
Qui sont les rédacteurs et le curieux rôle de Gérard le moine ? Ce sont bien sûr les moines de Saint-Nicolas, que la notice ait été ou non contemporaine du don. Mais la mention de Gérard le Moine comme devant vivre avec Buhardt et en même temps surveiller ou plus certainement s'assurer de la bonne gestion des biens donnés, est tout à fait inhabituelle. Buhardt est marié comme indiqué au début du texte et sa femme ne joue aucun rôle dans cette affaire. Le cas du décès de Buhardt dépouille totalement celle-ci des biens de son époux, et cela sans aucune contrepartie. On ne sait pas si elle est possessionnée. Souvent dans ce genre de texte, il est prévu que la veuve entre dans un couvent, mais ces entrées ne se font pas sans contrepartie et des dons sont prévus pour parer à cette éventualité. Le moine Gérard n'est cité dans aucun autre texte du cartulaire, ce n'est donc pas un dignitaire de l'abbaye. On peut s'arrêter sur la précision de l'habitat de Gérard. Buhardt écrit qu'il vit avec lui « in rupe mea », sur ma roche, mais pas dans sa domus. Il est plausible de voir dans ce texte une proximité, mais non une cohabitation qui aurait pu prêter à bien des questions. Nous sommes aussi à une époque où le nombre de frères convers est important et ils sont presqu'exclusivement dédiés au travail manuel. Il se peut que nous nous trouvions dans ce cas.
Le don, dans les mentalités de la seconde partie de ce siècle, est le moteur essentiel non seulement de l'économie des abbayes, mais encore de l'économie du salut.
La théologie augustinienne avait insisté sur la notion de péché originel et sur le caractère peccamineux des hommes. C'est, amplifié par les écrits apocalyptiques, un état d'angoisse vis-à-vis de l'au-delà qui s'étend sur la société. La peur de la mort et surtout de la mort subite, sans les secours de l'Église, qui ressort de la violence et de la précarité de la vie dissociée de la vieillesse, va contribuer à faire éclore l'idée du purgatoire. C'est un espace rude, mais consolant, car il est temporel. Cette nouvelle vision va entraîner l'accroissement du don comme « assurance » sur l'au-delà, la participation aux oeuvres des saints et donc la proximité avec la vie sanctifiante des moines. C'est bien dans ce cadre que nous nous trouvons. Buhardt ne demande rien d'autre en échange que la commémoration, par des prières, de sa mort, et ce par les moines et leur entourage. On voit poindre le nécessaire souvenir pour sanctifier la mort. Nous entrons dans ce qui a été décrit comme le « commerce de la mort »par l'Église.

Dans un premier temps, comme ici, ce sera le souvenir chronologique et l'inscription au Migravit des moines qui est privilégié, mais bientôt, ce souci sera complété et remplacé par l'effet cumulatif des messes, source de revenus et de consolation. Pour les théologiens de ce temps, le don aux moines, pauvres de Dieu comme ils se nomment, c'est le retour à Dieu de ce qu'il a prêté aux hommes leur vie durant. Les biens matériels ne sont qu'un usufruit, non une possession.
En conclusion, ce texte est sans doute un « faux-vrai » s'essayant à parer aux contentieux entre le chapitre Saint-Laud et l'abbaye Saint-Nicolas. Mais en dehors de l'intention de faciliter les transactions à venir, il montre d'une part l'intérêt de Saint-Nicolas pour l'aménagement fluvial, une réalité géographique et économique, et enfin il fait ressortir la culture des moines visant à entretenir la crainte, qui leur est profitable, d'une possible damnation dont ils possèdent l'antidote.
Source : Histoire des Coteaux de Loire et de Maine (Michel Pecha)
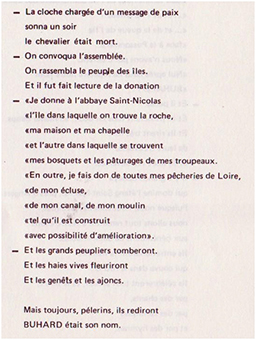
Document datant de 1076
Charte : Béhuard le Breton (...) a donné, à l'abbaye Saint-Nicolas d'Angers, deux Isles sur la Loire, dont la Roche-Béhuard.
Le comte Foulques (le Réchin), qu'on ramenait blessé du siège de La Flèche en descendant le Loir, a voulu récompenser immédiatement le prévôt d'Angers, Girard Folet, qui avait sauvé son embarcation au passage de la « porte » de Corzé et lui a donné une pêcherie à la Roche-Béhuard, que le prévôt voulait offrir à l'abbaye Saint-Nicolas. Peu après qu'il eut reçu du comte Foulques le Réchin une pêcherie à la Roche-Béhuard, puis en ait donné la moitié à l'abbaye Saint-Nicolas d'Angers, Girard Folet a accepté, moyennant 6 livres, de donner au monastère l'autre moitié avec l'autorisation du comte.
Source :. Le comte d'Anjou et son entourage : Éditions Picard
PEUPLEMENT ET MOTTES
De rares mottes ont été érigées sur des accidents de relief naturels. C'est le cas de la Roche de Buhard-le-Breton sur l'île de Béhuard, probablement là où se trouve l'église actuelle, construite au XVe siècle. Il s'agit de l'utilisation d'une roche, probable vestige d'une cheminée volcanique, d'une forme tronconique d'un peu plus de 10 m de hauteur.
Les mottes qui demeurent aujourd'hui sont rarement élevées à proximité des villages. Il convient de se garder d'en tirer une quelconque conclusion. En effet, sur les mottes repérées, soit près de 40 %,ont été construites en bordure de village : Belle-Noue, bien sûr, autour de laquelle Matthieu Giraud et Ulger vont ériger une paroisse ; Armaillé et Nyoiseau où des mottes sont attestées, mais ne sont pas localisées avec certitude. Pour Nyoiseau, le Cartulaire relève sa proximité avec l'abbaye, donc avec le village Béhuard où la Roche est au centre de l'île au milieu de l'actuel village. Au Plessis-Macé, la motte initiale se trouve aussi en bordure de village. La motte de La Possonnière est à côté de l'église paroissiale, ancienne chapelle castrale. La Salle à Saint-Georges-sur-Loire, qui a disparu sous les progrès de l'urbanisation, était proche de l'abbaye. La Forêtrie à Saint-Jean-de-Linières, autre motte disparue, était en bordure de l'agglomération. Le Château de Saint-Michel, ancienne paroisse et actuellement sur la commune de Saint-Michel-et-Chanveaux, était dans le territoire du village. La Guerche à Savennières, qui a peut-être été transformée en motte vers le XIe-XIIe siècle, se trouve entre église et Loire, dans une zone probablement rapidement habitée.
L'existence d'autres mottes en agglomérations et ayant disparu par suite de l'extension des villages ou de leur transformation par les notables ou les seigneurs successifs en habitats, ne peut n'y être méconnue, ni pouvoir être quantifiée. Sur l'échantillon, est-il vraiment représentatif ? qui a été recensé, une part significative a fait l'objet d'une construction avant la création du peuplement villageois. C'est le cas pour Belle-Noue, qui fait l'objet d'un contrat spécifique de peuplement, mais aussi de Béhuard dont la roche est in insula mea sans autre mention d'habitat que la propre maison de Buhard le Breton. Nyoiseau était établie avant l'abbaye, soit probablement avant la création d'une agglomération, puisque les textes précisent que l'ermite Salomon s'établit dans une zone déserte. Bien entendu, cette assertion doit être prise avec précaution : la présence d'une motte, fut-elle isolée, prouve que le territoire de la future abbaye n'était pas si désert que Salomon veut bien le proclamer en utilisant une formulation toute faite et récurrente de la création des abbayes. Un cas identique a pu se produire à Saint-Georges-sur-Loire avec la motte de La Salle. Il n'est malheureusement pas possible de déterminer si cette motte a disparu lors de la création de l'abbaye et si l'agglomération de Saint-Georges ne se développe qu'après l'arrivée des chanoines réguliers de Saint-Augustin, venus de l'abbaye de La Roë, à la seconde moitié du XIIe siècle.
Les mottes symboles de la puissance de la noblesse émergente seraient la motivation de leur construction à côté de la résidence seigneuriale ou au milieu des terres contrôlées. À Béhuard, l'utilisation d'un rocher pour élever une motte, est dite à côté de la maison de Buhard-le-Breton.
![]()
Le devenir des mottes
Les mottes n'ont que peu d'influences dans le long terme, tant du point de vue de l'organisation sociale que du paysage et de l'économie. Elles disparaissent du paysage, les châteaux reviennent dans la mouvance comtale et les croisades sont un espoir puissant, non seulement de salut éternel, mais encore d'enrichissement.
Comme nous l'avions relevé, les mottes étaient le symbole de l'action individuelle des nouveaux dominants. Elles s'inscrivaient dans une dynamique d'une évolution autarcique, méconnaissant le développement des échanges. Or le centralisme Plantagenêt s'inscrit dans une autre perspective. Aussi les mottes déclinent apparemment vers la fin du XIIe siècle. Les mentions rares des mottes ont quasiment disparues des textes. Nous ne connaissons pas leur destin.
Pour trois d'entre elles, nous pouvons l'imaginer. La motte de Buhard-le-Breton, mîles, avait été donnée par son propriétaire à l'abbaye Saint-Nicolas, peu de temps après la mort de Geoffroy-Martel. Cette motte, que l'on peut localiser sur l'actuelle île de Béhuard, occupait probablement le site de l'actuelle église(..donavi...duas scilicet insulas, unam in qua est rupes et domus mea et capella mea, alteram in qua sunt pascua pecorum et boscus ). Le texte précise bien que Béhuard était divisée en plusieurs îles, vraisemblablement cinq. L'indication de Rupes est significative de l'importance de l'élévation pour le donateur Buhard-le-Breton. Il indique aussi que la Capella était érigée en dehors de la roche dont la surface sommitale n'est pas très grande. L'église actuelle couvre une surface supérieure en utilisant des soubassements de pierre.
C'est le seul emplacement élevé de l'île, il était et demeure hors d'eau, même dans les crues les plus fortes. Il occupait le sommet érodé d'une cheminée volcanique, comme le château voisin de Rochefort. Or ce site a été occupé, postérieurement et à une date imprécise, par la construction d'une église. Il est probable que ce fut assez rapidement le cas, les moines n'ayant pas l'utilisation d'une structure de défense et de domination. Au contraire, ce lieu a été très rapidement utilisé comme centre de pèlerinage à la Vierge. (Pour Célestin Port, qui ne donne pas ses sources), le site a été occupé par un temple dédié à une divinité marine dès l'antiquité. Il relève que le duc de Bedford, régent de France (1422-1435), délivrait au XVe siècle des sauf-conduits pour ce pèlerinage. À la fin du XVe siècle, Louis XI fera des dons à l'église de Béhuard.
La disparition des mottes
Les mentions de mottes qui étaient fort rares disparaissent totalement à la fin du XIIe siècle. L'habitat qui y était joint n'a pas survécu. Si l'on prend comme exemple la motte du mîles Buhard-le-Breton dans l'île de Béhuard, elle n'est plus indiquée après la donation de 1060.
Sans doute, comme le relève le texte, Buhard-Le-Breton a continué d'y résider durant sa vie. Mais lors de son décès, elle est retournée à l'abbaye Saint-Nicolas. Les moines n'y ont pas établi de prieuré ni même de paroisse. Celle-ci n'apparaît que fort tardivement à l'époque moderne, après avoir été un lieu de pèlerinage. Elle reste attachée sous Louis XI à la paroisse de Denée, elle-même implantée sur la rive sud de la Loire (Comme l'indique une épigraphie dans l'église actuelle de Béhuard, rappelant la donation de Louis XI et l'obligation des chanoines de Denée de desservir ce lieu de culte).
Béhuard La Roche
La notice XIII du Cartulaire de Saint-Nicolas d'Angers vers 1060 rapporte le don par Buhard-le-Breton, un mîles, de tous ses biens aux moines de Saint-Nicolas. Il énumère ceux-ci et en particulier une île unam in qua est rupes et domus mea et capella mea. Ces termes sont significatifs de l'existence d'une demeure seigneuriale et d'une motte. Le terme de rupes indique l'existence d'une motte, même s'il s'agit d'un symbole de puissance plutôt que d'une réelle défense. Contrairement à certaines affirmations, il ne peut s'agir que de la roche située sur l'actuelle île de Béhuard, là où est érigée l'église actuelle et qui date du XVe siècle. Le socle de la motte est constitué des restes d'une cheminée volcanique, semblable à celle de l'île de Rochefort entre Louet et Loire. La taille est modeste et d'environ 20 m de diamètre avec une élévation inférieure à 10 mètres en son point le plus élevé. Ce site est au-dessus des plus hautes crues connues de la Loire, ce qui n'est pas le cas du reste de l'île.
Découvertes à Béhuard
 La famille des haches à talon est une des sept familles de la typologie des haches de l'Âge du bronze. La hache à talon comporte deux parties distinctes, le talon qui est la zone d'emmanchement et la lame qui prolonge le talon. Cette famille apparait sporadiquement en plusieurs régions à la fin du bronze ancien. Elle se développe au cours du bronze moyen (vers 1400-1200 av. J.-C.) dans toute l'Europe. Elle se prolonge jusqu'au bronze final, spécifiquement sur la façade atlantique du continent et particulièrement en Bretagne où l'on a trouvé plus de deux mille haches à talon. La famille des haches à talon est classée en deux grands groupes, à butée incomplète et à butée complète. Le groupe à butée incomplète comprend deux types, dont le type à écusson auquel est apparenté un exemplaire du Trésor de Plélan. Le groupe des haches à butée complète comprend neuf types, dont trois types spécifiquement bretons. (Le Musée archéologique de Nantes)
La famille des haches à talon est une des sept familles de la typologie des haches de l'Âge du bronze. La hache à talon comporte deux parties distinctes, le talon qui est la zone d'emmanchement et la lame qui prolonge le talon. Cette famille apparait sporadiquement en plusieurs régions à la fin du bronze ancien. Elle se développe au cours du bronze moyen (vers 1400-1200 av. J.-C.) dans toute l'Europe. Elle se prolonge jusqu'au bronze final, spécifiquement sur la façade atlantique du continent et particulièrement en Bretagne où l'on a trouvé plus de deux mille haches à talon. La famille des haches à talon est classée en deux grands groupes, à butée incomplète et à butée complète. Le groupe à butée incomplète comprend deux types, dont le type à écusson auquel est apparenté un exemplaire du Trésor de Plélan. Le groupe des haches à butée complète comprend neuf types, dont trois types spécifiquement bretons. (Le Musée archéologique de Nantes)
Source : Société préhistorique française no 10 1921
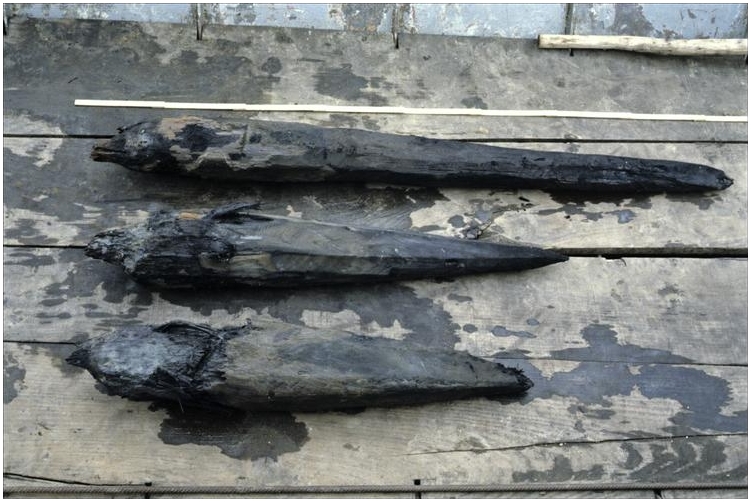
Vue de trois pieux de bois, trouvés à Béhuard, un à section carrée et deux à section polygonale.
(Fouille P. Grandjean/Drassm)
![]()
FERRÉTISATION MODERNE DES SABLES.
Dans tout le tronçon examiné ici, on rencontre assez souvent un faciès de sables, généralement grossiers, absolument normal comme composition minéralogique, mais dont les grains sont assez fortement liés par un ciment ferrugineux.
Il s'ensuit une roche ferme, de couleurs rouges vives et noirâtres ; cette dernière teinte ferait croire à la présence de manganèse comparée à ces roches superficielles si fréquentes sur les territoires primaires de la région et connues sous le nom de grisou ; mais une analyse a montré qu'il n'en était rien, le manganèse n'ayant pas été trouvé dans un échantillon typique. Cette roche a été rencontrée auprès du niveau d'étiage actuel, en particulier aux vieux puits de l'île aux Chevaux et des Aireaux, Elle a été recueillie au sein des sables, dans un puits à Béhuard.
Source : SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE Scientifique et Littéraire-DU VENDOMOIS
DÉVELOPEMENT DE BEHUARD
Dévotion à Notre Dame de Béhuard.
Il est difficîle de penser que le renom de Béhuard aurait eu du mal à franchir les limites angevines sans la faveur du Roi Louis XI.
Propriétaires de l'île
Mais qui possède les droits seigneuriaux sur Béhuard, avant la Révolution ?
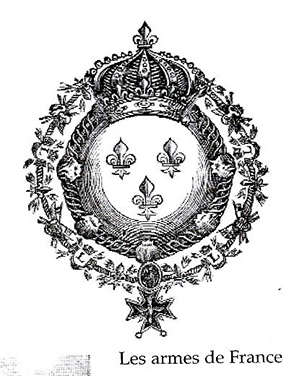
Béhuard est une île sur la rivière Loire, mais à qui appartiennent les eaux, les îles, les rives, les accroissements ? Depuis longtemps, le Roi a la propriété éminente des eaux et forêts. Louis XIV et son ministre Colbert, contrôleur général des finances, créent « la grande Ordonnance de 1669 » portant règlement général sur le fait des « Eaux et Forêts ». Le Roi a besoin d'argent. Colbert va réorganiser et faire respecter les droits royaux sur les eaux, forêts, prés communaux, rivières, chemins, levées. Louis XIV délègue « connaissance et juridiction » à ses sujets, seigneurs hauts justiciers, sous la tutelle du grand maitre et des officiers de la maitrise des « Eaux et Forêts ».
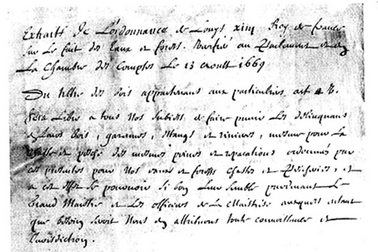
Extrait de l'ordonnance de Louis XIIII (XIV), sur le fait des eaux et forêts, vérifié au Parlement et à la Chambre des comptes, le 13 aout 1669.
Du titre des bois appartenant aux particuliers (art. V),il sera libre à tous nos sujets (possesseurs de fiefs) de faire punir les délinquants en leurs bois, garennes, étangs et rivières, même pour la chasse et la pêche et à cet effet, se pourvoir, si bon leur semble, par devant le grand Maitre et les officiers de la Maitrise, autant que besoin serait. Nous en attribuons toute connaissance et juridiction. (Arch. Serrant, liasse 243)
Suite à la déclaration du roi, «il est demandé aux possesseurs des îles, ilots et autres biens : atterrissements, accroissements, droits pèche, péages, passages, ponts, bats et autres droits édifices construits sur la rivière de Loire et autres navigables sur la généralité de Touraine, Anjou , Maine (division administrative de l'époque) de déclarer au fermier des domaines de sa majesté la quantité de biens possédés par eux et seront tenus de fournir les copies des originaux de leurs titres sous peine de la saisie de leurs biens... Ordonnance lue et publiée par cures qui devront fournir un certificat.
(Archives Serrant, liasse 242).
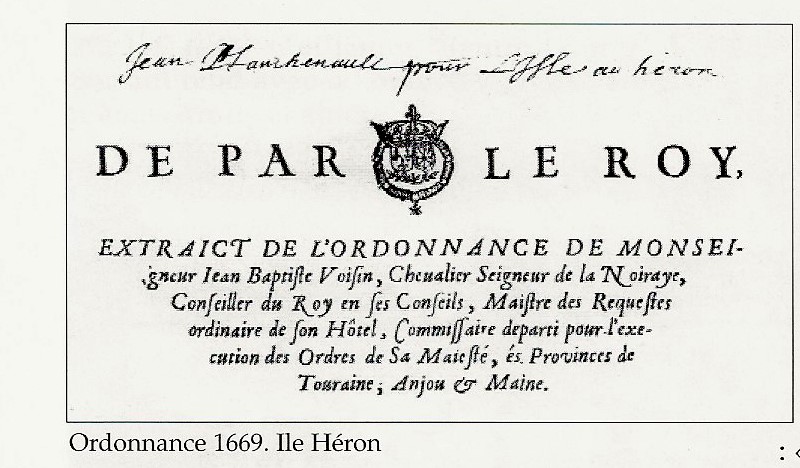
Jean Planchenault, propriétaire de l'île du Héron, près de Saint-Gemmes-Loire, s'est exécuté : il a calculé les revenus de ses biens sur la base, à valoir sur un an, de 20 livres par arpent de terre labourable, de 200 livres par moulin à bled, de 100 livres pour un moulin à papier, à tan et à foulon, puis a transmis ses titres de propriété et sa déclaration à son seigneur-justicier au greffe du comté de Serrant. En cas d'erreur, il risquait 500 livres d'amende.
Les terres de Béhuard et de la Roche aux-Moines
En 1431, Yolande d'Aragon, veuve du duc Louis II d'Anjou, est seigneur propriétaire du château et châtellenie de la Roche-aux-Moines, 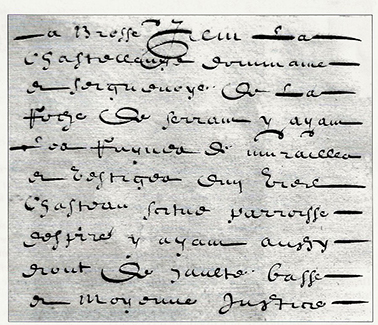 alias Roche-au-Duc (rappel d'appartenance au duché d'Anjou).Elle vendit la terre, les titres et droits attenants à Jean de Brie, seigneur de Serrant. De ce jour, la châtellenie avec ses dépendances est assujettie aux obéissances féodales et seigneuriales dues à Serrant. En 1481, le roi Louis XI, pour récompense des services rendus par Ponthus de Brie, voulut que cette terre de la Roche s'appelât la Roche-de-Serrant.
alias Roche-au-Duc (rappel d'appartenance au duché d'Anjou).Elle vendit la terre, les titres et droits attenants à Jean de Brie, seigneur de Serrant. De ce jour, la châtellenie avec ses dépendances est assujettie aux obéissances féodales et seigneuriales dues à Serrant. En 1481, le roi Louis XI, pour récompense des services rendus par Ponthus de Brie, voulut que cette terre de la Roche s'appelât la Roche-de-Serrant.
Le 12 avril 1540, Péan de Brie s'avoue sujet du roi pour son chastel, chastellenie, fief, terre et seigneurie de la Roche de Serrant avec ses dépendances. (ADML E1832. Notes de Audouys)
«Item, la chastellenye, domaine et seigneurye de la Roche de Serrant y ayant les ruynes de murailles et vestiges d'un vieil chasteau scitué parroisse d'Espiré, y ayant aussy droict de haulte, basse et moyenne justice foncière, prévosté, etc, etc... rentes et debvoirs fonciers et féodaux par grains et deniers, poulailles, bans et corvées, droictz de servitudes, droictz de primevertz (première pêche) de poissons et autres proficts honorifiques de ladicte châtellenie de la Roche de Serrant en l'estendue des parroisses d'Espiré, Sapvenierre, Bouchemaine, St Georges sur Loire, St Martin du Fouilloux, St-Nicollas les Angers, la Trinitté de la ville d'Angers, Apvrillé, Mozé, Ste lame sur Loire et autres...»
(Arch. Serrant, liasse 206)
![]()
En 1633, le roi Louis XIII accorde à Bautru,
Futur seigneur de Serrant, des droits sur les nouveaux accroissements et îles qui se sont formés dans la rivière de Loire.
« De par le roi, le sieur Bautru, conseiller en notre conseil d'Etat, et conducteur de nos ambassadeurs, nous ayant requis à lui accorder, de lui faire don des îles et accroissements qui se sont faits dans les rivières de la Loire et du Cher... je sais que son mérite vous est connu... comme il me fait l'honneur de m'aimer et que je suis obligé de rechercher les occasions de le servir, j'ai estimé... que je devais vous convier de lui rendre sur cette affaire, les offices que j'ose me promettre de cette courtoisie... que je ressentirai cette faveur comme si elle m'était faite à moi-même...» Signé : LOUIS
(Arch. Serrant, liasse 242)
En 1636, Bautru acquiert la seigneurie de la Roche-de-Serrant comprise dans la vente de toutes les terres du comté de Serrant .
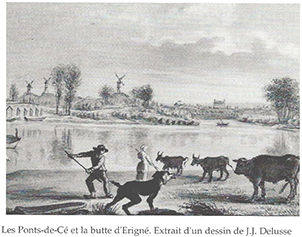
Les droits d'eaux et d'accroissements sur la Loire dépendants de la Roche-de-Serrant s'étendent de Saint-Saturnin-sur-Loire jusqu'à Savennières.
Toutefois, la Loire étant une zone économique intense, des espaces sont réservés à l'évêque d'Angers (seigneur de Saint-Alaman), à l'abbaye Saint-Aubin, au seigneur de Murs, au chapitre Saint-Laud pour l'exploitation des moulins et des pêcheries.
Un document provenant des Arch. de Serrant, liasse 242, nous renseigne sur ce sujet :
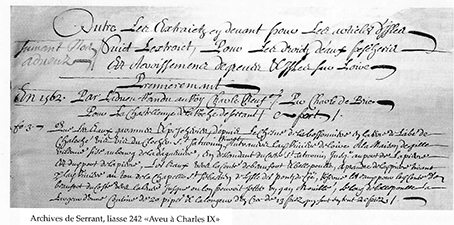 1er : En 1563, Charles de Brie, seigneur des fiefs de Serrant rend aveu au roi Charles IX pour la châtellenie de la Roche-de-Serrant.
1er : En 1563, Charles de Brie, seigneur des fiefs de Serrant rend aveu au roi Charles IX pour la châtellenie de la Roche-de-Serrant.
« Outre... suict l'extraict pour les droictz d'eaux, pescheries et accroissemens de grèves et isles sur Loire ».
Que les eaux, garennes et pêcheries depuis le chêne de la Bossonnière en la terre de l'abbé de Chaloché vis-à-vis du clocher Saint Saturnin jusques à la Coupehardière au-dessous des Ponts de Cez m'appartiennent.
Depuis ledit toit de la chapelle St Sébastien de l'île des Ponts de Cez jusques à la Coupehardière au-dessous des Ponts de Cez, ces eaux m'appartiennent ;
Depuis ladite Coupehardière en contreval du côté de la vallée jusqu'à la maison feu Jean Laguette au village de l'île Embardiere (Lombardières), paroisse de Rochefort, et dudit lieu tirant au travers de la rivière au clocher St Romain de Saveniere, réservé au sgr de Meurs (Murs) le long de sa terre treize pieds de large.
Réservé aussi du côté de Ste lame depuis la Coupehardière au travers la rivière jusques au dessous du Port Thibault à une borne et depuis ladite borne étant au-dessous de ladite roche de Serrant du Port Thibault tirant contre-val jusques au chêne Besland, les eaux m' appartiennent.
Et depuis le chesne Besland jusqu'à la borne Hamonneau qui est la pointe des doictz (duits) de Ruzebourg, ces eaux m'appartiennent.
Sont et réservés au long des duits pour les doyens et chapitre, seigneur de Ruzebourg, joignant les terres de Ruzebourg la longueur d'une centine étant au long desdits duits et la longueur d'un croc de treize pieds au travers desdites eaux pour réparer lesdits duits seulement et non pour y pêcher et du bout desdits duits tirant à la pierre tendue de Bécherelle au-dessous de Chantourteau, du côté de Bescherelle et depuis Bescherelle toutes les eaux de la rivière au travers d'icelles m'appartiennent.
Et en tirant contre val jusques au clocher St Romain de Savenières dont je jouis et fait pêcher, etc. »
2e. En 1645, Guillaume Bautru, comte de Serrant, rend aveu à Louis XIV ; il déclare les mêmes droits et ajoute :
« Item, ai droit de port et de passage tant à chaland que charrière sur mesdites eau.
Item, en outre mes anciennes îles et accroissements, j'ai droit par toutes mesdites eaux tant au-dessus desdits Ponts de Céz qu'au-dessous de prendre et d'appliquer à moi les grèves, îles et accroissements nouveaux qui se trouveront, à les planter ou les faire planter ou à les bailler à telles personnes à cens, rentes et devoirs et à payer à moi et à ma recette de ma châtelenie de la Roche de Serrant.
Item, j'ay le droit sur les épaves et challans chargez ou vides etc.
Guillaume Bautru doit avouer au Roi la nature et les revenus de ses biens. Il sera imposé en conséquence et devra payer des redevances. En échange, ainsi que nous le révèle le document, il bénéficie de tous les droits du Roi sur ses fiefs, dont celui d'arrenter ses terres, ses eaux et autres.

Nous n'allons citer que quelques-unes de ces îles et grèves de Loire situées entre Saint-Saturnin et Savennières :
- près Juigné, la belle île de Serrant, les Butasseaux, l'île du Désert à la Pusselle
- L'île naissante entre l'île au Bourg et l'île Merdière
- L'île Torchon au-dessus des Ponts de Céz, l'île du Buisson
- L'île Godard du côté de la vallée de Fosse (Les Jubaults), l'île Maugin vis-à-vis Ste Gemme, l'île du Port Thibault et les grèves,
- L'île nommée les Vannes, alias l'île des Chauveaux,
- L'accroissement du sieur Fouscher, situé entre le Buisson Chef d'oeil, le Buisson des Chauveaux, les îles Collas, du Conté et des accroissements desdits Bonnamis.
- Une portion de l'île Chevrière.
- Les îles Miot, Pichery et l'île Neusve.
- Les îles aux Geuz, Chamboureau, L'île Madame.
- L'île aux joyaux.
- Les îles Bigottière, Doussard - Le port Godard.
- L'île des Loges, alias les îles Laguette, du Sept, Piau et Patarin.
- L'île du Champ Doiseau - L'accroissement de la Tour - La taille Moreau, une portion au dessous de la chapelle aux Jobeaux,
- L'île Béhuard, partie de laquelle est la chapelle.
- L'île appelée Sainte Marie en dessous dudit Béhuard, laquelle appartient à madame abbesse du Ronceray (Le Merdreau).
Une pêcherie apellée l'écluse en la boire du Louet. (La plupart des îles et accroissements portent en général le nom de son premier preneur, exemple : « Torchon » ; par contre l'île des « Loges » a changé plusieurs fois de nom).
Guillaume Bautru conforte ses droits de seigneur, conformément aux aveux rendus au Roi par lui-même et ses prédécesseurs, sur une grande partie des eaux de la Loire entre Saint-Saturnin et Savennières. Ses successeurs les conserveront jusqu'à la Révolution.
Mais il devra se battre pour garder son autorité sur cette portion de Loire si convoitée et, comme nous le verrons plus tard, ce ne sera pas de tout repos.
Droits du Seigneur de Serrant
La limite des droits du seigneur de Serrant, sur les eaux de la Loire était située au niveau de la pierre de la Mouillardière, vis à vis la queue de l'île de Béhuard.
Un document, daté de 1719, sorti des Arch. de Serrant liasse 1026, raconte qu'avant « que les bureaux (des fermes) fussent à la Pointe, les bateaux étaient obligés de s'arrêter à cette pierre de la Mouillardière pour aller acquitter à Savennières où était le bureau dans la maison du Frêne appartenant à monsieur Dargonne, conseiller honoraire au présidial ; anciennement la queue de l'île de Béhuard descendait jusqu'au droit de cette pierre.
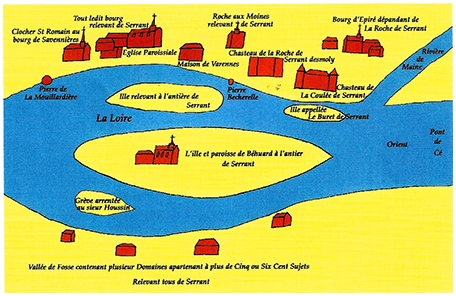
Cette pierre a été enlevée et placée sur le boulevard de la Possonnière ; c'était bien une borne car on y trouva dessous du carreau et de l'ardoise... plusieurs personnes l'ont vue et même, Pierre Vételé qui la charroya avec 24 bœufs dit qu'elle était plantée sur bout. Cette pierre serait celle dont parle l'aveu qui déclare en raison de droits sur les eaux : « ainsi à prendre depuis Bécherelle, tirant contre val, vis à vis le château (de la Roche-aux Moines) jusque à la pierre de la Mouillardière».
Il y avait un problème à l'époque : la borne, elle, restait en place ; par contre la rivière Loire diminuait chaque année la queue de l'île de Béhuard. Il a été proposé de dresser un procès-verbal pour marquer la limite d'étendue des eaux de la Roche-de-Serrant et faire planter une nouvelle borne
![]()
Les conflits sont fréquents pour la propriété de la terre.
Les rapports de procédures sont nombreux.
Chacun devra « exhiber » ses titres devant l'autorité judiciaire, en l'occurrence le service des Eaux et Forêts, qui les examinera pour leur conférer ou non une légitimité. Les faux sont fréquents.
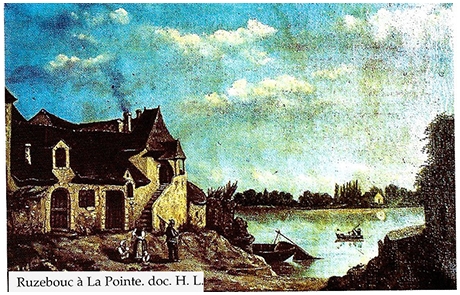
Pour illustrer notre propos nous allons citer trois rapports extraits des Archives de Serrant :
1ere affaire : Chapitre St-Laud contre Comte de Serrant pour l'île Chevriere (Arch. Serrant 242) octobre 1664. Procès-verbal fait par Boumier, notaire royal, à Angers, suite à procès en cours ; par devant les seigneurs des requêtes du Palais à Paris pour raison de certaines grèves et accroissements trouves dans la rivière de Loire en queue d'île Chevriere.
Les vénérables chanoines du chapitre de l'église royale et collégiale de St-Laud-les-Angers ont formé opposition prétendant que l'île Chevriere leur appartenait toute entière, de même la moitié des eaux de la rivière Loire à cause de leur seigneurie et châtellenie de Bouchemaine et Ruzebourg.
Le comte Guillaume de Bautru, chevalier, seigneur de Serrant, chancelier, garde des sceaux, et chef du conseil de monsieur d'Orleans, frère du roi, soutient que les sieurs de St-Laud n'ont là aucun droit d'accroissements ni pêcheries dans la rivière de Loire, que toutes les eaux, îles, accroissements, pêcheries lui appartiennent au dedans des bornes et limites, aveu rendu au roi tant par ses prédécesseurs, seigneurs de la Roche de Serrant, alias la Roche au Duc.
S'ensuit une description des lieux, des essais d'arrangement.
II est décidé que M. Le Boultin, conseiller en la Cour, rapporteur du procès, descendrait sur les lieux et qu'en sa présence il serait fait figure et description des choses par un peintre ; les titres de chacune des parties pourraient être confrontées avec ladite figure.
Un arrangement amiable est conseillé afin d'éviter les grandes longueurs et frais et terminer ledit procès, paix et amour nourrir entre eux. Des huissiers maitres-arpenteurs vont se transporter à cheval sur les lieux. Des bornes vont être plantées. Nous possédons le rapport d'arpentage ; il nous reste à trouver le plan.
Rappel : La seigneurie de « La Roche-de-Serrant » nominée autrefois « La Roche-au-Duc » et auparavant « La Roche-aux-Moines » dépend du comte de Serrant.
2eme. Affaire : rivalité Justice de Brissac contre Justice de Serrant (Arch. Serran 1026) :
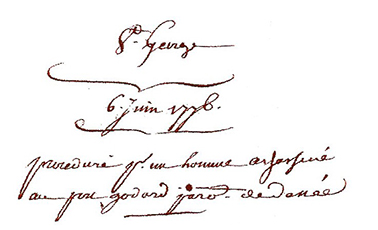 L'acte du greffier du comte de Serrant est daté du 6 juin 1776. Un nommé Manceau, employé des gabelles, habitant de la vallée de Fosse entre Béhuard et la Pointe, est décédé hier des suites de maltraitements et coups qu'il reçut dimanche, à la sortie du cabaret de Sébastien Leduc, au village du Port-Godard, vis à vis Béhuard.
L'acte du greffier du comte de Serrant est daté du 6 juin 1776. Un nommé Manceau, employé des gabelles, habitant de la vallée de Fosse entre Béhuard et la Pointe, est décédé hier des suites de maltraitements et coups qu'il reçut dimanche, à la sortie du cabaret de Sébastien Leduc, au village du Port-Godard, vis à vis Béhuard.
L'enquête a été menée, les actes l'attestent par la haute justice de Serrant. Pourtant un autre document sortant également des archives de Serrant nous apprend que la justice de Brissac doit descendre aujourd'hui ou demain sur place, que le lieu du Port-Godard dépendant de la seigneurie de Mantelon relève des terres de Brissac. Cependant, les droits de Serrant arrivent jusqu'au Port-Godard, sur la rivière de Louet, et même que la boire des Saullayes adjacente en fait aussi partie.
3e Affaire
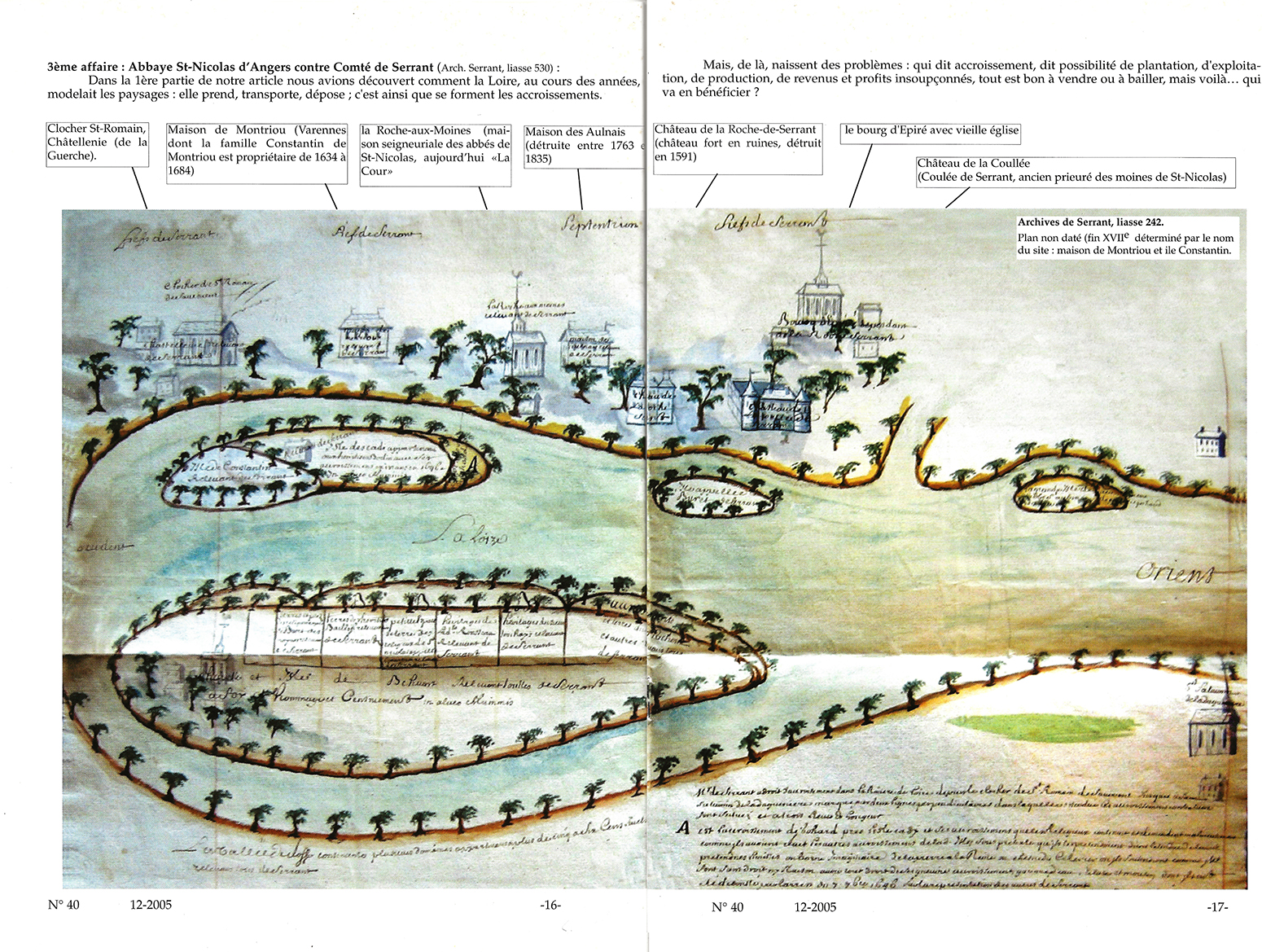
Le plan en couleurs ci-dessus, si joliment décoré, a été dressé par les religieux de St-Nicolas d'Angers qui contestent au seigneur de Serrant 3 accroissements :
L'accroissement A, arrente à Gohard, est situé, sur le plan, à l'est de l'île Cady vis à vis de la Roche-aux-Moines (l'île Cady et l'île Constantin (de Montriou) forment l'île des Guesses alias île de Varennes ou encore île de Savennieres).
L'accroissement B, arrente en 1639 à Richoust et Quartier (nom du premier preneur et depuis appelé île Quartier), est situé sur le plan au nord de Béhuard vis à vis de la Roche-aux-Moines, au-dessus des "héritages" du sieur Touchays, de la delle Rousseau, d'un espace de terre aux religieux eux-mêmes, de terres aux héritiers Baillif, et d'un bois auxdits religieux.
L'accroissement C, en bout Est de la grande île de l'abbé de St-Aubin, est situé vers Orient sur le plan, vis vis de Ste-Gemmes.
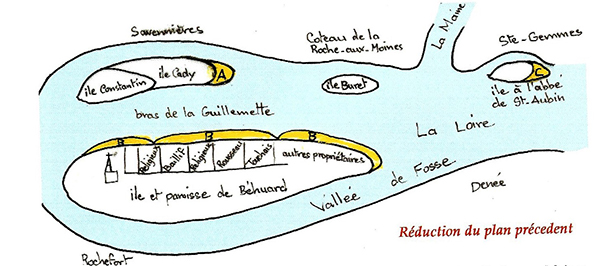
Bien qu'à chaque fois débouté par des arrêts de la Cour royale, les religieux récidivent « malicieusement> en se prétendant dans des droits de limites.
Nous pourrions également citer des différends avec l'abbesse du Ronceray, l'évêque d'Angers et autres qui sont, également, possesseurs de droits dans cette partie de Loire, à cause de titres détenus depuis des lustres, souvent d'anciennes donations des comtes d'Anjou. Vu le peu de crédit apporté aux titres anciens bien souvent faux, peu précis, vu le caractère changeant des rives et des îles de la Loire, il est difficîle de trouver des solutions immédiates. La terre procure des profits honorifiques, économiques et financiers abondants, elle a une valeur inestimable. Il n'y a pas d'autres solutions, pour faire reconnaitre ses droits et ses titres que de passer devant un conseil de notaires royaux.
Ces difficultés à affirmer ses droits n'empêchent pas le comte Walsh de Serrant, entre 1759 et 1782 d'acheter des terres sur les paroisses de son comté ; il acquiert ainsi les îles de Mesurage., de la Jametrie et l'île Neuve. Il agrandit ses superficies plantées en vignes ; nous savons qu'il possède déjà un très beau fleuron : la « Roche-aux-Moines avec la très célèbre Coulée de Serran, le tout d'une superficie de 19ha 35 a. (Arch. Serrant, liasse 63)
Béhuard dépend de la seigneurie de la Roche-de-Serrant, elle-même relevant du comte de Serrant
Chaque propriétaire rend foi et hommage à son seigneur.
Le Seigneur contre ses Vassaux
Convocation aux assisses de 1761
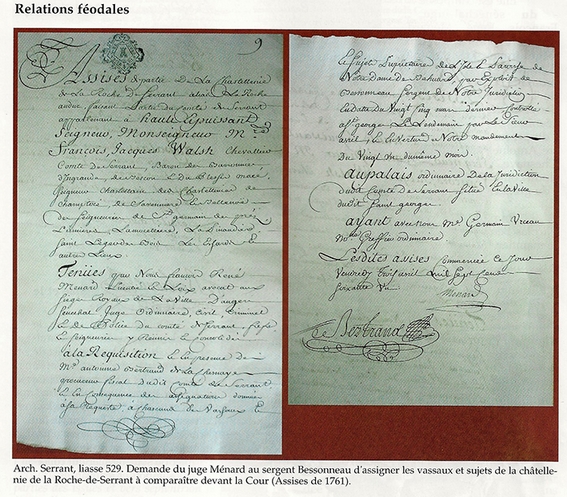
Le seigneur, propriétaire éminent : Béhuard dépend de la châtellenie de la Roche-de-Serrant, faisant partie du comté de Serrant appartenant à haut et puissant Seigneur, Monseigneur, Mre (messire) François, Jacques Walsh, chevalier comte de Serrant. A cette époque, sont encore apparentes, vis à vis Béhuard, les énormes ruines du château?- Le vassal et sujet, tenancier d'un fief ou d'un simple lopin de terre qu'il soit noble, ecclésiastique ou roturier, est dominé, assujetti ; il doit obligatoirement déclarer à l'administration de sa seigneurie tout achat, échange, vente, donation, acquisition, succession ; ce n'est pas un acte anodin ; il s'agit là de reconnaissance de hiérarchie de propriété, le seigneur ayant la propriété éminente et son tenancier la propriété utîle. Ne pas se soumettre à cette obligation est considéré comme un refus d'obéissance et donc comme un affront.
La Cour :
Elle est composée :
- Du sénéchal-juge : François René Ménard, licencié es lois, avocat aux sièges royaux de la ville d'Angers, sénéchal juge
- Du procureur fiscal : maître Antoine Bertrand de la Chesnaye, procureur fiscal dudit comté de Serrant,
- Du greffier Urceau.
- En plus, un sergent,
- Nicolas Bessonneau, assure le maintien de l'ordre.
Le contrevenant peut se voir retirer ses terres jusqu'à la réparation. Le seigneur perçoit, en plus, un droit sur tout transfert de propriété. La situation foncière de chacun est inscrite sur plusieurs registres ; les « assises » permettent de confronter les déclarations aux titres et actes notariés et d'actualiser la situation foncière de chacun. Justement les situations sont parfois confuses, facilitant les supercheries . La cour convoque, écoute, juge et inflige des amendes.
Le noble est l'araignée et le paysan, la mouche.
Opulent et dédaigneux, le noble est comparé à une araignée attirant dans sa toîle le pauvre paysan. Plus on a de moyens, plus on en veut avoir. Ce pauvre apporte tout : bled, fruit, argent, salade. Ce gros Milord assis, prest à tout recevoir ne luy veut pas donner la douceur d'une œillade. C'est en réalité son fermier ou sous-fermier qui collecte les impôts et redevances de la Roche-de-Serrant, alias la Roche-aux-Moines qui sont des marques de puissance gravées dans le paysage.
La propriété foncière à Béhuard en 1761..
La terre sous l'Ancien Régime : symbole de pouvoir.
A cette époque, les paysans constituent le fondement de la société. Ils produisent l'essentiel de la richesse du royaume. Plus de 80% des gens sont des ruraux et près de 3 sur 4 des paysans. C'est dire l'importance du monde de la terre, également l'importance de sa valeur.
Les rapports entre les hommes et la possession de la terre sont complexes : hérités du Moyen Age, selon l'adage «nulle terre sans seigneur". Les grands seigneurs baillent leurs terres à des nobles et des bourgeois qui, à leur tour, baillent à de plus petits propriétaires.
L'ordre social est bâti sur la propriété foncière. La possession de la terre, même en quantité infime, procure une considération en proportion avec la quantité possédée.
La «coutume d'Anjou» : un recueil de lois.
Au Moyen Age, de puissantes dynasties féodales se constituent. Elles créent elles-mêmes des réseaux vassaliques tenant d'une main ferme les «vilains» astreints à redevances et contraintes mais, en contrepartie, protégés par le château et nantis de terres. La société féodale est progressivement de mieux en mieux organisée. Les droits et devoirs de chacun sont nettement fixés et consignés dans des chartes appelées aussi coutumes. L'Anjou possède sa coutume qui est la référence en matière de droit et de laquelle dépendent les relations sociales.
En 1761, les sujets de Béhuard vivent donc contraints et forcés sous le règne de la «coutume d'Anjou» et sous la tutelle de leur seigneur et maître, le comte de Serrant, de qui ils détiennent leurs terres. Pour chaque parcelle, le détenteur est dépendant et doit payer une redevance annuelle, le cens.
Le «cens» : un impôt foncier
Etienne Réthoré, laboureur, pour des terres en Béhuard : au pré des Rües, aux Brunelleries, aux Géars, aux Sablons, doit payer 51 sols de cens. Le cens est le symbole de la supériorité, du devoir, de l'obéissance, du respect ; les censitaires sont les hommes du seigneur, ses sujets et vassaux. Ceux-ci ne sont propriétaires qu'à la condition qu'ils promettent et s'obligent à payer le cens qui doit être réglé spontanément sans que le seigneur n'ait à en faire la demande. Il pouvait l'être en argent, en nature ou mixte avec une partie en argent et autre partie en volailles, céréales ou encore journées de travail.
Le plan-terrier : ancêtre du cadastre.
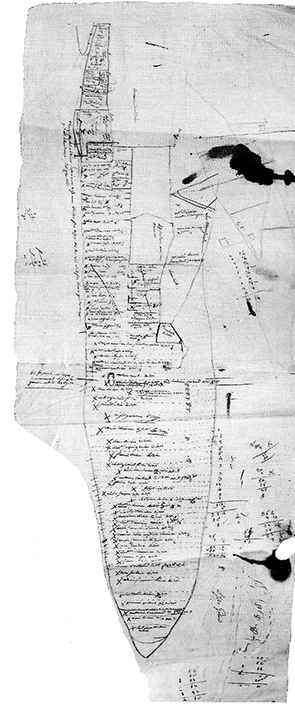
Le terrier est la description de la seigneurie à un moment donné. C'est un document public, établi avec l'autorisation du roi, et réalisé avec le concours des tenanciers. On a très souvent ajouté des plans au registre terrier, surtout au XVIIIe siècle. Certains plans, espèce de pré-cadastre, présentent l'état parcellaire des héritages (biens) avec l'indication des noms des propriétaires.
Ci-joint : un brouillon censif de la partie nord de Béhuard en 1761.
Ce plan a été trouvé dans les archives de Serrant, liasse 529. Il mesure environ 50 cm de large sur 70 cm de long. Destiné uniquement à la collecte des redevances (voir les croix devant les noms des propriétaires ainsi que les chiffres griffonnés sur la partie droite), il est de présentation fort négligée : le repérage y est difficîle. Après examen, nous remarquons que seule la partie nord de Béhuard y figure. Nous n'avons malheureusement pas, à ce jour, trouvé les autres plans du reste de l'île.
Brouillon censif de 1761. Essai de restitution sur 2 pages.
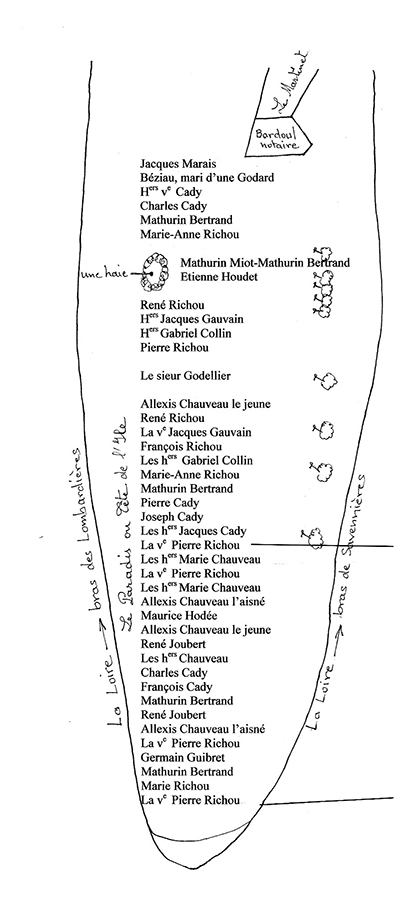 Le plan de la page précédente a été agrandi et traité par moitié sur 2 pages. La Tête de Ille (vers La Pointe) est en bas, Savennières-La-Roche-aux-Moines à droite et Les Lombardières-Denée à gauche. Nous lirons les noms des propriétaires à partir du bas : la veuve Pierre Richou est donc la propriétaire possédant la parcelle située en extrême bout d'île, du côté de la Pierre-Bécherelle. Sur le plan original, marge de gauche, une note a été ajoutée : il y avait une haie et l'on nommait le surplus Paradis ou Teste de l'Isle. Ainsi ce canton couvre-t-il la partie qui va du bas du plan à la haie. Nous remarquons sur la droite des arbres, peut-être une saulaie. En haut de page, Le Martinet appartient aux moines de St-Nicolas-lès-Angers, fondateurs du prieuré de la Coulée de Serrant
Le plan de la page précédente a été agrandi et traité par moitié sur 2 pages. La Tête de Ille (vers La Pointe) est en bas, Savennières-La-Roche-aux-Moines à droite et Les Lombardières-Denée à gauche. Nous lirons les noms des propriétaires à partir du bas : la veuve Pierre Richou est donc la propriétaire possédant la parcelle située en extrême bout d'île, du côté de la Pierre-Bécherelle. Sur le plan original, marge de gauche, une note a été ajoutée : il y avait une haie et l'on nommait le surplus Paradis ou Teste de l'Isle. Ainsi ce canton couvre-t-il la partie qui va du bas du plan à la haie. Nous remarquons sur la droite des arbres, peut-être une saulaie. En haut de page, Le Martinet appartient aux moines de St-Nicolas-lès-Angers, fondateurs du prieuré de la Coulée de Serrant
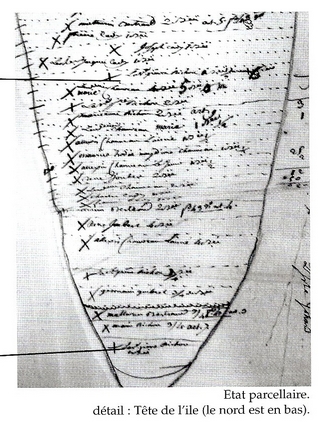
Les propriétaires de Béhuard en 1761 :
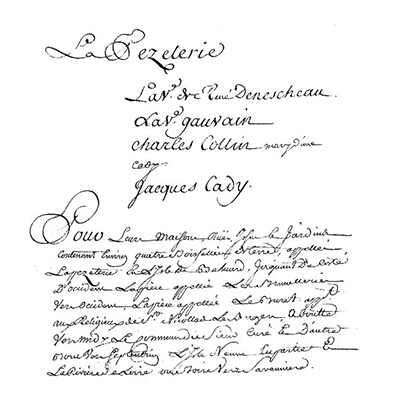 Pour seulement l'île, le nombre de possesseurs de terre est impressionnant. L'île est ainsi, dans toute son étendue, divisée en une grande quantité de parcelles, résultat de divisions successives.
Pour seulement l'île, le nombre de possesseurs de terre est impressionnant. L'île est ainsi, dans toute son étendue, divisée en une grande quantité de parcelles, résultat de divisions successives.
Quelques habitants de l'île semblent plus aisés ; ils détiennent des terres, pour eux et leurs ayants-droits, depuis de nombreuses générations : les Cady, Réthoré, Richou, Collin, Leduc, Joubert, Giffard, Chauveau, Bourrigault, Bertrand, Godelier, et d'autres. Certaines de ces familles sont toujours existantes à Béhuard.
A partir des registres d'assises de 1761, nous avons essayé d'établir une liste des propriétaires de maisons d'alors Elle n'est sans doute pas complète en raison de l'existence d'un fief particulier, celui du curé de Denée, desservant de Béhuard, vassal également du comté de Serrant, mais gestionnaire de ses biens propres en l'île.
(transcription du document ci-dessus)
La Pezeterie
La vve de René Denescheau
La vve Gauvain
Charles Collin, mary d'une Cady
Jacques Cady
Pour leurs maisons, rues, issues et jardins, contenant environ quatre boisselées de terre, appelés la Pezeterie en l'île de Béhuard, joignant du côté d'occident la pièce appelée le Buret appartenant aux religieux de St-Nicolas-les-Angers, aboutant vers midi le commun du sieur curé et, d'autre bout, vers septentrion, l'île Neuve en partie et la rivière de Loire ou boire vers Savennières
Hameau de Béhuard
MARTIN (Joachim), écuyer, sieur des Loges, mari de Charlotte Galisson, fut autorisé en 1627 par la ville d'Angers a ouvrir, sous les halles, un manège pour l'instruction de la noblesse et de toutes autres personnes de condition et qualité. Il établit en 1629 près les Carmes en l'hôtel du Petit-Guéméné et se transporta cette année à Casenove, là même où devait être installée plus tard la célèbre Académie d'équitation. Il meurt à Erigné et est inhumé le 12 octobre 1652 dans l'église de Béhuard.
Source :Dictionnaire historique biographique du Maine et Loire
Histoire de Béhuard

L'île a la forme d'un bateau dont la proue fend le cours de la Loire. Elle a quatre kilomètres de long sur à peine un de large. Presque en son centre, s'élève une roche siliceuse d'origine éruptive, témoin immobîle des bouleversements géologiques, qui ont donné naissance au Massif Armoricain et sur laquelle Louis XI a fait ériger la gracieuse chapelle de la Vierge qui semble avoir surgi des eaux.
Autour du rocher, se sont accumulés, au cours des siècles, sables et limons, arbres et débris, charriés par les inondations. Par ensablement progressif, plusieurs îles se sont réunies pour n'en former plus qu'une. Ainsi le prouvent certains chemins légèrement vallonnés, anciennes boires où se perdaient autrefois des bras du fleuve, et, comme en témoignent les noms de « la Vieille-île », « l'île-Verte », « l'île-Griveau », que nous retrouvons dans les actes anciens, et ceux de « la Vacherie », « l'île-de-Mer-Madame » et « l'île-Marie », cités par l'historien Grandet au XVIIe siècle, la Loire façonna d'abord plusieurs îlots puis elle les réunit en un seul banc étroit qu'elle ne cessa de modeler et qu'elle modèle encore. (A. Fauvel)
Deux actes notariés :
Arrentements ou de baux.
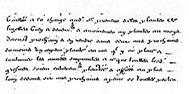 Voici le premier, le 22 septembre 1650, Marthe Le Bigot-Bautru, comtesse de Serrant, accorde un bail à Maurice Foucher pour une grève et accroissement, situés près de l'île Chevrière à Bouchemaine entre l'île du Comté, un petit îlot arrenté à Bonnamy et le buisson Chédail, à la charge dudit preneur de le planter en luzettes (osiers) à commencer au mois d'août prochain et en rendre compte dans deux ans et continuer les années suivantes à augmenter jusqu'à ce que lesdites grèves soient entièrement plantées et assises, cordelage et arpentage fait au bout de 6 ans.
Voici le premier, le 22 septembre 1650, Marthe Le Bigot-Bautru, comtesse de Serrant, accorde un bail à Maurice Foucher pour une grève et accroissement, situés près de l'île Chevrière à Bouchemaine entre l'île du Comté, un petit îlot arrenté à Bonnamy et le buisson Chédail, à la charge dudit preneur de le planter en luzettes (osiers) à commencer au mois d'août prochain et en rendre compte dans deux ans et continuer les années suivantes à augmenter jusqu'à ce que lesdites grèves soient entièrement plantées et assises, cordelage et arpentage fait au bout de 6 ans.
Dans le second acte, le 27 novembre 1658, Guillaume de Bautru, comte de Serrant, alloue à René Maugin, Monier de la Varenne et Pierre Planchenault la Belle-île-de-Serrant près du bourg de Juigné à la charge desdits preneurs de planter et asseoir la grève de plants de saules, léards (peupliers) et  luzettes et à faire de ce jourd'hui à 5 ans, à la fin duquel temps cordelage sera fait par des experts de monseigneur le comte de Serrant.
luzettes et à faire de ce jourd'hui à 5 ans, à la fin duquel temps cordelage sera fait par des experts de monseigneur le comte de Serrant.
Également, trouvé dans le cartulaire de l'abbaye de St-Georges-sur-Loire, un bail d'arrentement au Port-Girault, entre Rémond Revoire, prieur de l'abbaye et Michel Bessonneau, vigneron au village de La Leu, à la Possonnière, pour la boire du Bouttonnier, lequel terrain n'est pas propre au pacage des bestiaux, il est recommandé d'y faire des plantations pour la conservation des levées. De nombreuses îles vont de cette façon être progressivement réunies ou rattachées à la rive. Afin de concentrer les eaux dans un seul chenal, propre à la navigation, on construira des barrages entre les îles.
Décrypter les cartes et les plans ,
Décrypter les cartes et les plans pour comprendre l'évolution des paysages
A côté de très nombreux documents écrits, les documents cartographiques portant sur la Loire, sont nombreux. Les Archives nationales, départementales, les Ponts et Chaussées ont en leur possession de nombreux plans et cartes qui racontent l'évolution perpétuelle des paysages.
Les cartes anciennes
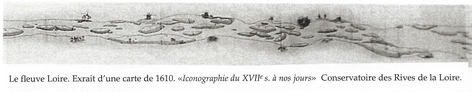
Gravées, elles sont parsemées d'îles de fantaisie. Voici une carte de 1610 qui nous promène d'une rive à l'autre avec, posées là, n'importe où, en grand nombre, des îles qui ressemblent à des «patates».
Les cartes du XVIIe et du XVIIIe siècles.
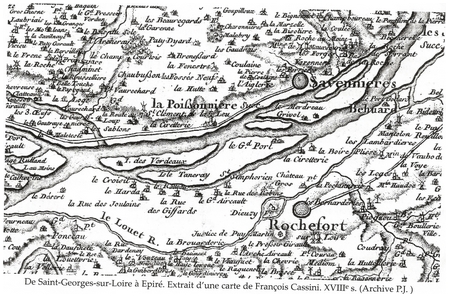
Elles séduisent par la minutie de la représentation et la richesse des couleurs. Conformes aux traités de l'époque elles distinguent les différents types de paysages en les rendant agréables par des teintes aussi proches que possible de la vie. Cependant, elles comportent parfois des erreurs de localisation ou de toponymie. Elles mentionnent l'existence des objets représentés mais ne les figurent pas toujours avec exactitude, telles les cartes du dessinateur Bonvoux, notre inspecteur des ouvrages de la Loire dans la seconde moitié du XVIIe siècle
Les documents sont produits à partir de besoins. Ils sont, le plus souvent, commandités par le roi, les ministères, les ingénieurs. En 1720, sur ordre de Louis XV, Jacques Cassini père dessine une carte des duchés, selon les observations de l'Académie des Sciences. En 1750, son fils François Cassini propose au roi une nouvelle édition de la carte qui mesure 10mx10m et qui a demandé 40 ans de travail. Les objets représentés sont scientifiquement recensés, mais, là encore, il vaut mieux être prudent sur la justesse de la localisation.
![]()
Période de la Révolution
Les Communes
Les communes ont été créées à la Révolution. Elles ont pris le nom des paroisses qui les précédaient ou ont pu en prendre un nouveau pour ôter une référence religieuse ou à l'Ancien Régime.
On retrouve leur nom dans les actes officiels et depuis 1943 dans le Code officiel géographique. Des changements ont pu intervenir au cours des évolutions réglementaires ou des modifications de leur territoire.
En 1795, Béhuard fait partie du canton de Savennières.
Comité de mendicité de la constituante
Notre Dame-de-Béhuard (telle est la dénomination retenue) est peuplée de 74 feux, soit 315 habitants. On doit y assister 5 vieillards trop fatigués et « 30 enfants de pauvres » trop jeunes pour travailler, 20 pauvres malades » les années ordinaires » (c'est-à-dire sans épidémie). On invoque bien sûr « le peu de travail, le trop d'impositions, le ravage des eaux ». On souligne que « Notre-Dame-de-Béhuard est située milieu de la rivière de Loire et ne contient que 1200 boisselées, 400 ha de terres, en ce compris l'île Murault, peu labourable, le reste en chaintre, lisettes et sable ». Plaintes et requêtes ne sont pas surprenantes : « diminuer les impôts et avoir un bureau de charité ».
Mairie
Construite en 1860-1864 par l'architecte RICHOU
Maires
Maires
1790 Jacques Cady
1792 Charles René Colin dit l'Abbé Colin
1819 Pierre-Jean Richou
1837 Mathieu Richou
1848 Jacques Boussard
1871 André Gaignard
1884 ? Richou-Roinard
1892 Charles Cady-Vaslin
1896 Mathurin Leduc
1900 François Rhétoré
1908 Bertrand Trottier
Epicerie
En 1856 il y avait à Behuard deux épicerie
M.BERNARD ET M.MERLET
Légion d'honneur
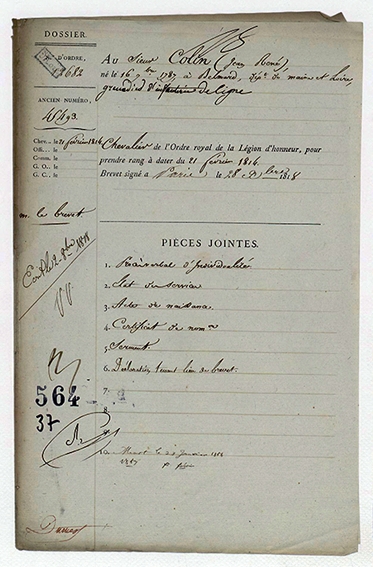 1814-Légion d'honneur à Mr COLIN
1814-Légion d'honneur à Mr COLIN
Les réfugiés de la Vendée
 Le clergé a d'abord " marché " pour les nouvelles idées, la nouvelle philosophie. Les sociétés de Francs-Maçons (qui n'avaient pas de caractère anticlérical à cette époque) comptèrent un certain nombre d'ecclésiastiques, puis la politique et les exaltés de la Révolution allèrent plus avant, en particulier on exigea le serment constitutionnel, ce que beaucoup refusèrent, s'offrirent à la persécution : emprisonnement, l'exil ou la mort (échafaud, fusillade ou noyade). Que firent les membres du clergé dans notre coin ? Les uns se cachent sur place et continuent pratiquement à desservir la paroisse, (ce que fera Barbedette) ; d'autres s'éloignent quelque peu, mais là où ils sont, reprennent du service. La paroisse de Savennières par exemple bénéficia deplusieurs auxiliaires à cetteépoque, en 1796 et 1797, Michel Caillou, curé des Rosiers. René Mesnard, vicaire de Martigné-Briand, le remplace et célèbre aussi dans des paroisses avoisinantes ; un vicaire de Beaucouzé, Pierre Gervais Renou qui se cache aussi dans lecoin, dessert la paroisse de Savennières en juillet 1797. Maintenu au Concordat, il meurt en 1832. Il y a aussi ceux qui s'éloignent, ceux qui s'exîlent volontairement en Espagne ou en Angleterre, par exemple ; ceux qui subissent et acceptent le martyre ou la déportation
Le clergé a d'abord " marché " pour les nouvelles idées, la nouvelle philosophie. Les sociétés de Francs-Maçons (qui n'avaient pas de caractère anticlérical à cette époque) comptèrent un certain nombre d'ecclésiastiques, puis la politique et les exaltés de la Révolution allèrent plus avant, en particulier on exigea le serment constitutionnel, ce que beaucoup refusèrent, s'offrirent à la persécution : emprisonnement, l'exil ou la mort (échafaud, fusillade ou noyade). Que firent les membres du clergé dans notre coin ? Les uns se cachent sur place et continuent pratiquement à desservir la paroisse, (ce que fera Barbedette) ; d'autres s'éloignent quelque peu, mais là où ils sont, reprennent du service. La paroisse de Savennières par exemple bénéficia deplusieurs auxiliaires à cetteépoque, en 1796 et 1797, Michel Caillou, curé des Rosiers. René Mesnard, vicaire de Martigné-Briand, le remplace et célèbre aussi dans des paroisses avoisinantes ; un vicaire de Beaucouzé, Pierre Gervais Renou qui se cache aussi dans lecoin, dessert la paroisse de Savennières en juillet 1797. Maintenu au Concordat, il meurt en 1832. Il y a aussi ceux qui s'éloignent, ceux qui s'exîlent volontairement en Espagne ou en Angleterre, par exemple ; ceux qui subissent et acceptent le martyre ou la déportation
.Dans notre secteur il y a la Loire. On la considère d'ordinaire comme une barrière qui séparerait au sud ; les Vendéens et au nord ,des gens plutôt du côté des Bleus (Chalonnes comptait surtout des Républicains). A Rochefort-sur-Loire , le curé refuse le serment avec ses deux chapelains (ou vicaires), il est déporté en Espagne, il reviendra au Concordat ; il est remplacé à Rochefort par Moreau de Béhuard.
Source : Histoire des Coteaux de Loire et de Maine
Des réfugiés de la Vendée morts dans des bateaux à Béhuard
Les habitants remarquèrent-ils les bateaux lourdement chargés de prisonniers à destination des noyades de Nantes décidées par Carrier La commune de Béhuard, qui couvre l'île du même nom sur la Loire angevine, se situait en 1793 aux avant-postes républicains face aux insurgés de la rive gauche, très présents à Denée. Elle n'a cependant pas connu d'événements majeurs à cette époque, sinon qu'elle accueillit des réfugiés de la Vendée, comme l'indique son registre d'état civil de l'an II.

On appelle"réfugiés de la Vendée"
Les habitants des territoires insurgés de la Loire-Inférieure, du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres et de la Vendée, qui ont fui leur domicîle par milliers pour gagner les régions restées fidèles à la République, soit dans les villes périphériques (Nantes, Angers, Saumur, Fontenay, Les Sables, etc.), soit au-delà, vers les Charentes, vers Le Mans, ou le long de la vallée de la Loire La Loire fut d'ailleurs un itinéraire très emprunté par cet exode à la fois pour les riverains du fleuve et pour les personnes originaires du sud du pays nantais. Les registres d'état civil de Béhuard conservent la trace de trois décès d'enfants de réfugiés de la Vendée, survenus au cours de l'été 1794 dans des bateaux conduits par des « voituriers par eau », et dont les actes ont été établis par Charles-René-Jean Colin Le 3 messidor an II (21 juin 1794) ont comparu Pierre Pineau, voiturier par eau, 40 ans, domicilié à Montrelais (Loire-Inférieure) et Charlotte Huchet, filassière, 30 ans, domiciliée à « Montglone » (nom révolutionnaire de Saint-Florent-le-Vieil) ; lesquels ont déclaré que Pierre Pottier, âgé de 26 mois, fils de Martial Pottier, filassier, et Charlotte Huchet (le couple s'est marié le 10 février 1789 à Saint-Florent-le-Vieil), est mort ce jour sur les cinq heures du matin « dans les bateaux dudit citoyen Pierre Pineau, conducteur des réfugiés de Montglone restés devant notre commune ». Le 24 thermidor an II (11 août 1794) ont comparu René Doussard, voiturier par eau, 56 ans, domicilié à Chalonnes, et Jeanne « Cléné » (Clénet), 38 ans, domiciliée à « Meudon » (Maisdon-sur-Sèvre) ; lesquels ont déclaré que Marie « Brongé » (Branger), âgée de 5 ans et quelques mois, fille de « Blais Brongé » (Blaise Branger) et de Jeanne Clenet (le couple s'est marié le 28 janvier 1777 à Maisdon-sur-Sèvre), est morte ce matin à cinq heures « dans les bateaux du citoyen Doussard restés devant laditte commune de Béhuard dans la rivière de Loire ». Marie Branger était née le 19 octobre 1788 à la Haie-Trois-Sous, paroisse de Maisdon. Le 29 thermidor an II (16 août 1794) ont comparu le même René Doussard et Marie Boidron, domiciliée à Saint-Fiacre (Loire-Inférieure), âgée de 48 ans ; lesquels ont déclaré que « Jean Airault, âge de huit ans, fils de Pierre Airault, cultivateur, et de Marie Boidron, domiciliés de la commune de Saint Fiacre est mort hier sur les onze heures du soir dans les bateaux du citoyen René Doussard, chargés de réfugiés de la Vendée et restés devant laditte commune de Béhuard à cause des vents contraires ». Or, on ne trouve aucun Airault à Maisdon pour cette période. Le maire de Béhuard a mal compris le nom. Il s'agit en fait de Pierre Météreau (ou Métaireau), marié à Saint-Fiacre le 24 janvier 1769 avec Marie Boidron, dont il eut un fils, Jean, né le 14 mars 1785 à Saint-Fiacre. À noter que la fuite de ces réfugiés de Saint-Fiacre et de Maisdon eut lieu quelque temps après l'expédition dans ces communes d'une colonne sortie du camp de la Roullière au début du mois de juin 1794.
D'autres décès de réfugiés de la Vendée, originaires de Chaudefonds-sur-Layon, sont mentionnés dans le même registre, mais ces derniers sont décédés sur la terre ferme, et non dans les bateaux amarrés à l'île :
Le 8 fructidor an II (25 août 1794) est constaté le décès de Claude Bênard, tonnelier, 52 ans, domicilié à Chaudefonds et réfugié chez le citoyen Mathurin Bertrand, mort la veille.
Le 17 fructidor an II (3 septembre 1794), Guy Bompas, 31 ans, cultivateur, et Françoise Papin, son épouse, 30 ans, tous deux domiciliés dans la commune de Chaudefonds et « réfugiés dans celle de Béhuard à cause des brigands de la Vendée », ont déclaré que Marie Bompas, leur fille, âgée de 3 mois, est morte la veille.
Source : Vendéens et Chouans- Guerre de l'Ouest (Vendée-Chouannerie)
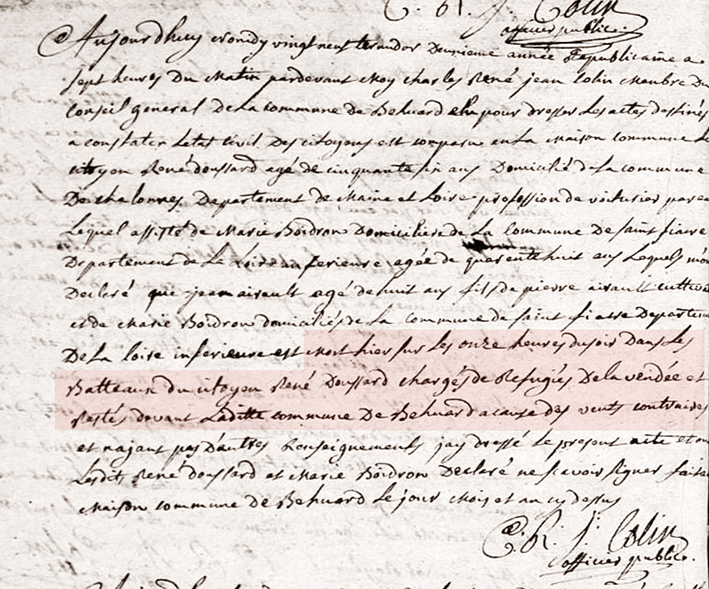
Acte de décès de Jean Métaireau (noté : Airault), le 16 août 1794, « dans les bateaux du citoyen René Doussard, chargés de réfugiés de la Vendée… » (A.D. 49, état civil de Béhuard, NMD 1793–An VIII, vue 19/74)
![]()
Les Prêtres de Behuard sous la Révolution
Le curé, René Moreau, né à Angers en 1738, installé à Béhuard en 1788 , prêta serment et fut récompensé de son allégeance en se faisant élire curé de Rochefort le 22 mars 1791.Il remplaçait le curé Boulloys (1740-1812) insermenté (déporté en Espagne, il en reviendra et reprendra son poste) comme ses deux vicaires Jean-Damase Marais, lui aussi déporté, et Pierre Boussinot (1764 1842), exilé en Angleterre, puis revenu et clandestin. Quant à René Moreau, selon C. Port, il renonce à toute fonction ecclésiastique le 4 décembre 1793 et décèdera à Saint-Aubin-de-Luigné en 1816, désigné sur l'acte de décès comme « prêtre » (Avait-il exercé un ministère sous le Concordat ?). Simon Gruget en trace un portrait ambivalent « Monsieur Moreau, curé de Béhuard, fit aussi le serment. Il était bon prêtre, mais cependant très borné. Les sollicitations qu'il eut de la part de sa famille le déterminèrent à le prêter ».
Pierre Bouvier (ou Lebouvier) le remplaça comme prêtre constitutionnel de Béhuard en 1791 il signe son premier acte le 2 septembre 1791. L'intervalle fut donc assez bref entre le départ du curé Moreau et l'arrivée de son successeur environ 5 mois (au cours desquels, d'ailleurs, René Moreau revenait de Rochefort à Béhuard pour administrer des sacrements, qu'il signe « curé de Rochefort, cy-devant curé de N.D.de Béhuard ». Pourtant, cette absence de curé, qu'il fût assermenté leur importe peu, est vécue douloureusement par les habitants de Béhuard. D'où cette délibération de le municipalité datée du 26 mai 1791, signée: maire, Jacques Cady et de six autres conseillers. Elle est adressée à Messieurs les Administrateurs du Département de Maine-et-Loire » et non pas à l'évêque, ce qui atteste que les élus communaux ont bien compris qu'avec la constitution civîle du clergé, les prêtressont des fonctionnaires relevant des autorités civîles. Mais si la démarche est bien conforme aux procédures administratives, le contenu et le ton de la requête expriment un réel désarroi devant le manque, même provisoire , d'un « pasteur ».
« La Communauté (le choix de ce terme, plus affectif que celui de la commune », est révélateur) de Notre-Dame de Béhuard (telle était encore la dénomination officielle) vous expose que se voyant dépouillée de son pasteur, surtout dans le temps le plus précieux, le temps des Pâques l'emploi du pluriel suggère plutôt la communion pascale que la fête de la résurrection de Jésus), Monsieur Jacques Cady; maire, aurait en conséquence convoqué le Conseil Général de cette commune de rassembler ce jour dans la salle de la Municipalité pour délibérer et présenter requêtes et pétitions à messieurs les administrateurs [...] »:
Le premier argument avancé à l'appui de cette demande est le caractère exceptionnel du lieu du point de vue religieux avec ses fondements anciens où l'historique se mêle au prodigieux.
« C'est Louis XI, Roy de France, qui a fondé et institué l'église de Notre Dame de Béhuard, l'an 1469, et ce après un miracle prodigieux que la Sainte Vierge Marie, qui en est la patronne, a opéré en sa faveur. L'on voit déjà depuis plusieurs siècles des voyageurs y venir de toutes les parties du Royaume, pour chercher des secours, des guérisons miraculeuses qu'ils n'ont pas manqué de trouver dans cette tendre et charitable Mère, aujouirdhuy plus de prestre en Béhuard, plus de pasteur, ainsi donc plus de confiance pour les voyageurs (sur la Loire), plus de guérisons, plus de dévotions, plus de religion. On va donc tout abolir ! Non, messieurs, nous sommes bien éloignés de croire que ce sont là vos sentiments. Autrement dit, il est inconcevable d'ignorer les besoins spirituels des fidèles, et de négliger un tel capital historique (aujourd'hui, on préciserait même « touristique »).
Un autre argument invoque spécificité géographique du site « Vous comparez l'isle de Béhuard à la vallée de Rochefort » on croit comprendre par-là que les administrateurs ont décidé de supprimer la« succursale » de Béhuard en l'intégrant à la paroisse de Rochefort dans le cadre de la réorganisation induite par la constitution civîle du clergé , notamment pour des raisons budgétaires, en réduisant le nombre de prêtres, désormais payés par 'État. « Mais ce n'est point du tout comparable, parce que la vallée de Rochefort à un port, toujours allant et venant, pour ainsi dire nuit et jour ; c'est comme s'il y avait un pont. Chalonnes a ces mêmes secours et dont vous connaissez les profits. Béhuard n'est point semblable aux deux autres. L'isle est environnée de toutes parts par la rivière de Loire, sans aucun port ni ressource de passage. Notre isle étant trop petite pour former une paroisse, et ne pouvant s'étendre ny d'un côté ny d'autre, ne demandons pas qu'elle soit paroisse ; mais elle a toujours été succursale et a eu un prestre de résidence qui a toujours administré tous les sacrements. Et ce sont là toutes nos demandes : que nous soyons succursale et que nous ayons un prestre résident. Et par exemple qui sera le prestre le plus intrépide et le Plus effronté (audacieux) qui osera au milieu de de la nuit la plus agitée et la plus noire exposer sa vie sur une eau débordée, et s'engloutir dans les glaces par un temps d'hiver pour aller au secours d'un pauvre moribond. C'est là exposer et celui qui va chercher et celui des habitants de qu'il va chercher à périr tous les deux. Comment envoyer les enfants au catéchisme et aux instructions publiques. C'est les exposer à périr et à se noyer. S'il y avait un port, on dirait le passage est libre. Mais non, n'en ayant point, le passage est périlleux. C'est ce qui occasionnera les trois quart des habitants de Béhuard à n'entendre seulement pas la messe festes et dimanches rapport à l'incommodité du passage ».
L'agrémentation est insistante : l'île ne dispose pas de port, c'est-à-dire de quai ; ce qui soumet la navigation aux aléas du temps ; un prêtre résidant hors de l'île serait obligé de naviguer par tout temps et courrait des dangers, autant que son batelier ; or la disponibilité d'un « pasteur» est impérative car la satisfaction des besoins spirituels des fidèles est incontournable. Ces besoins, ce sont la messe du dimanche, le catéchisme assorti d'une alphabétisation élémentaire, et les derniers sacrements aux mourants.
C'est la résidence du vicaire qu'il faut obtenir. Alors, on argumente encore : « Ainsi, il n'en peut résulter aucun désavantage pour l'État que l'isle de Béhuard soit succursale comme elle l'a toujours été; qu'elle relève de Savennières ou de Denée (pourquoi pas Rochefort ?), peu nous importe.
Qu'un vicaire y consomme là sa pension, ou ailleurs, puisqu'il faut le payer, et qu'il fasse là ses fonctions, cela ne peut être nuisible en rien, tant à l'intérêt général, qu'à l'intérêt particulier ».
Les requêtes s'achèvent par les formules d'usage, avec l'espoir qu'elles seront satisfaites, « vu qu'elles sont très justes, fondées sur de puissants motifs, convenables à l'utilité publique, à la religion et à l'instruction de la jeunesse ». Et en effet, Pierre Bouvier sera nommé vicaire résident de la succursale de Béhuard. Pour combien de temps ? En tout cas c'est un autre desservant concordataire, Pierre Piffard, qu'on y trouve en 1803.
Source: Entre Loire et Bocage par Robert AUDOIN
Office Religieux « Hors-la Loi » à Béhuard
En 1790, l'Assemblée nationale vote « la Constitution civîle du clergé » qui réorganise l'Eglise de France sans consultation de la papauté. Les évêques et les curés sont élus et payés par l'État. Ils doivent prêter le serment de fidélité au Roi : « Je jure d'être fidèle à la Nation, à la Loi, au Roi et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi. » La majorité des ecclésiastiques angevins refusent ce serment, en particulier dans les Mauges.
 Ce refus a des conséquences nuisibles à la bonne marche des élections et à la mise en place du clergé constitutionnel. La situation, en beaucoup d'endroits, devient conflictuelle. De nombreux curés réfractaires vont continuer à remplir leurs fonctions souvent avec la complicité des municipalités. Ce fut le cas à Béhuard ; des documents d'archives le confirment.
Ce refus a des conséquences nuisibles à la bonne marche des élections et à la mise en place du clergé constitutionnel. La situation, en beaucoup d'endroits, devient conflictuelle. De nombreux curés réfractaires vont continuer à remplir leurs fonctions souvent avec la complicité des municipalités. Ce fut le cas à Béhuard ; des documents d'archives le confirment.
Chaque fois que la venue d'un commissaire de la république était signalée, racontait-on dans la famille Corbin, on embarquait en hâte le trésor du sanctuaire et le bateau allait s'ancrer au beau milieu du fleuve, comme pour une pêche.
Premier document daté du 22 avril 1796, rapport d'un commissaire auprès du juge de paix de Rochefort-sur-Loire
On enterrait, ce jour-là, Perrin Réthoré, 25 ans, du Bas-Griveau, et Jean Marais, 73 ans. « Rochefort, 3 floréal, an 4 républicain
Citoyen commissaire,
Je remplis un des devoirs que me trace votre circulaire du 10 germinal relative à l'exécution des lois rendues sur la liberté et la police des cultes, en vous disant que j'ai vu , ce jour, à Buhuard (Béhuard), canton de Savennières, huit filles vêtues de blanc, précédées d'un crucifix, porter en terre deux corps flanqués de deux grosses croix de bois : il ne manquait au cortège que « la bête noire ». Ce qui m'a le plus surpris, c'est que l'agent municipal de ladite commune de Bhuard venait d'aider au calotin à dire et chanter cette même messe et que, voulant dans un lieu public désabuser le peuple sur ces singeries, j'ai été singulièrement étonné d'entendre un vétéran national me dire que si personne n'avait voulu porter lesdites croix, il les aurait portées lui-même. Une des filles de confiance de l'agent municipal de Bhuard portait une des croix.
La commune de Bhuard a toujours paru être patriote ; elle a un prêtre et se roidit déjà contre les lois. Combien ces êtres sont dangereux.
Salut et fraternité. Jh Clémanceau, Commissaire provisoire.
"'Noté en marge : « Rochefort, reçu le 4 floréal ; le 11 floréal, écrit envoyé au président de l'administration de Savennières"
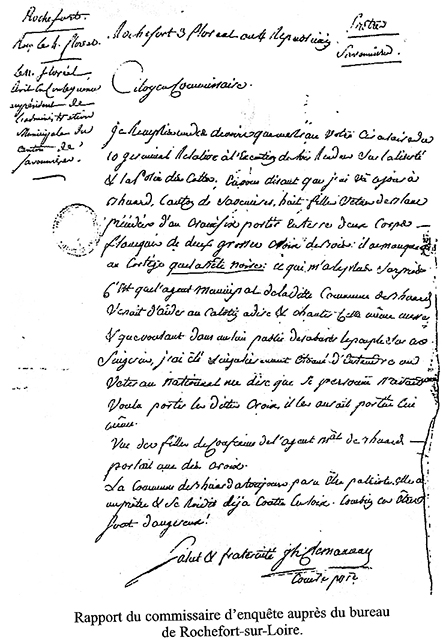
Les fidèles sont convaincus que les sacrements conférés par les nouveaux prêtres sont invalides. Considérés comme non-légitimes, ceux-ci rencontrent souvent de grandes difficultés.
Très vite, les autorités organisent la répression contre les réfractaires qui, dès 1792, vont être déportés vers l'Espagne et l'Angleterre. Certains se cachent avec le soutien des populations. Ceux qui sont pris sont emprisonnés à la Rossignolerie (aujourd'hui lycée David d'Angers)
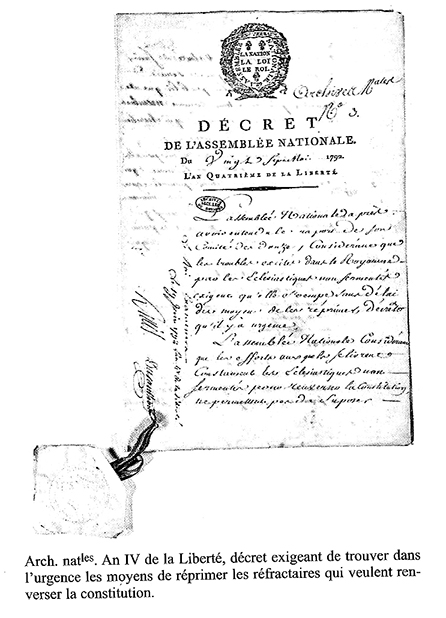 Un peu plus tard, les premiers traités de pacification entre la République et les armées vendéennes avaient permis d'obtenir un rétablissement partiel de la liberté religieuse à l'intérieur des églises ; toutefois, à l'extérieur, toute manifestation était interdite. A Béhuard, les deux habitants eurent donc droit à une messe de sépulture dans l'église, mais les habitants de Béhuard crurent pouvoir les accompagner jusqu'au cimetière avec un crucifix et deux croix.
Un peu plus tard, les premiers traités de pacification entre la République et les armées vendéennes avaient permis d'obtenir un rétablissement partiel de la liberté religieuse à l'intérieur des églises ; toutefois, à l'extérieur, toute manifestation était interdite. A Béhuard, les deux habitants eurent donc droit à une messe de sépulture dans l'église, mais les habitants de Béhuard crurent pouvoir les accompagner jusqu'au cimetière avec un crucifix et deux croix.
Le soir même, partait pour Angers, une dénonciation circonstanciée. On notera que le prêtre, ici appelé « la bête noire », se conformant à la loi, n'était pas sorti de l'église.
Deuxième document trouvé dans les archives municipales de Savennières, copie d'une lettre adressée au commissariat central par le commissaire auprès du tribunal correctionnel rapportant le déroulement d'une « chasse à l'homme » sur Savennières-Epiré : Le commissaire se console de tant d'échecs parce qu'il est sur une piste : il s'agit d'un prêtre du canton de Savennières ; mais peu importe, le salut de la République ne connaît point de frontière.
Il écrit donc tout de suite, 30 juillet, au citoyen Bonnet, commissaire près l'administration municipale du canton de Savennières : «Je pense bien que, comme nous, vous avez fait des visites domiciliaires, mais que, comme aux nôtres, les réfractaires se sont soustraits à vos recherches. Il en est un cependant qui n'abandonne pas votre canton. Je veux parler de celui qui, dit-on, célébrait, avec affectation, l'année dernière, à Savenières, avant le 18 fructidor et qui a fait mourir de chagrin le prêtre constitutionnel qui célébrait dans l'île de Béhuard. C'est un homme de cinq pieds un pouce environ, figure longue maigre et pâle, nez long et recourbé, âgé de 45 à 50 ans, vêtu d'un long gîlet de moueton roussâtre fin et usé, une culotte noire, bas gris et sabots vieux, chapeau rond de forme moyenne. Cet individu a été vu hier à sept heures du matin, sortant le chemin creux d 'Epiré, pour aller à Chantourteau. Cet être court habituellement les métairies de votre canton avec un ceran sur le dos, contrefaisant le filassier. Cependant hier il ne le portait pas : cela l'eût embarrassé pour dire la messe. Je crois qu'un pareil individu est de bonne prise. Tâchez de nous l'envoyer à la Rossignolerie, et je vous en complimenterai. Je penserai qu'il pourrait se nicher en certains temps dans le village de la Roche-aux-Moines. Salut et fraternité. »
La Révolution a voulu créer une Eglise nationale, adaptée à l'administration intérieure : un diocèse par département avec des évêques et des curés élus par des assemblées locales. Elle a exigé d'eux le serment de fidélité. Cela a engendré dans nos régions des troubles graves et la guerre civîle en Vendée. La présence de deux clergés ne pouvait qu'entretenir un climat conflictuel ; il fallait trouver la clé de la pacification à la question religieuse. En 1802, Bonaparte essaie de rétablir la paix en signant un accord avec le pape, le Concordat, mais à la condition de prêter serment au nouveau régime. La majorité des curés constitutionnels se soumettent. Au lendemain des prestations de serment, le préfet de Maine-et-Loire, Nardon, écrit : « Au nom de Bonaparte, tout se meut, tout marche, tout s'électrise. »
Source :Histoire des Coteaux de Loire et de Maine
BEHUARD -MILITAIRE
Campagnes Napoléoniennes
La campagne d'Allemagne, dont la campagne de Saxe est la partie centrale, est la suite de la campagne de Russie de 1812 et précède la campagne de France de 1814. Elle se déroule au cours de l'année 1813 et constitue le véritable tournant de la guerre liée à la Sixième Coalition. Les États allemands soumis par Napoléon, devant ses premières défaites, se retournent contre lui l'un après l'autre et se joignent à la Sixième Coalition autour de la Russie. Après la bataille de Leipzig, du 16 au 19 octobre, l'armée française vaincue doit se replier vers la France
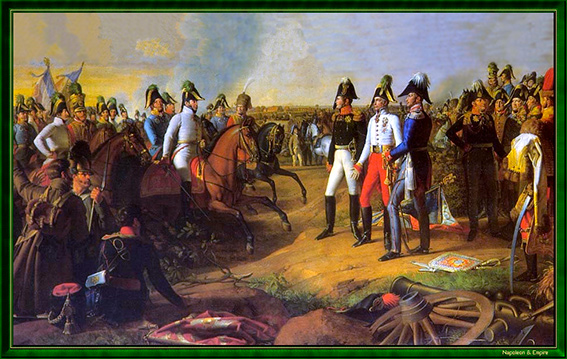
Soldats Béhuardais pendant les Campagnes de NAPOLÉON
GUERIN Julien
 Né le 18/08/1794 à Béhuard
Né le 18/08/1794 à Béhuard
- Père : Guerin Jean
- Mère : Leduc Renée
Métier :Laboureur
Matricule 9409
Militaire Sous Napoléon 55e régiment d'infanterie de ligne, 10 mai 1811-27 mai 1813 (matricules 7 804 à 9 603).
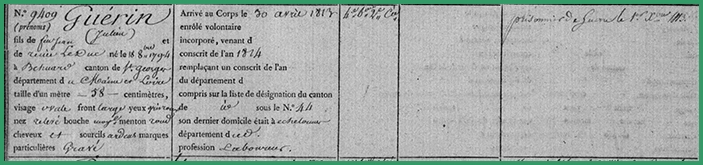
COLLIN Jean René
 Né le 16/09/1787
Né le 16/09/1787
- Père : Collin Jean René
- Mère : Marchand Anne
Matricule 4763
Militaire Sous Napoléon
40e régiment d'infanterie de ligne, 3 prairial an XIII [23 mai 1805]-14 avril 1808 (matricules 3 001 à 5998)
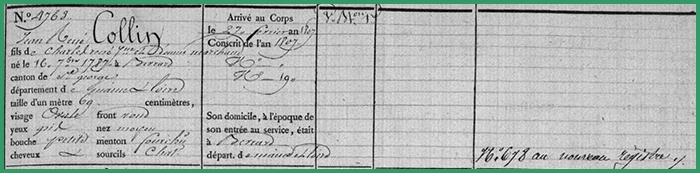
BERNARD Jean Pierre
 Né le 27/06/1787 à Béhuard
Né le 27/06/1787 à Béhuard
- Père : BERNARD Jean Jacques
- Mère : Marchand Jeanne
Matricule 48563 Militaire Sous Napoléon
40e régiment d'infanterie de ligne, 3 prairial an XIII [23 mai 1805]-14 avril 1808 (matricules 3 001 à 5998GODARD François
 Né le 16/04/1794 à Béhuard
Né le 16/04/1794 à Béhuard
- Père : GODARD François
- Mère : GODARD Jeanne
Métier :Laboureur Matricule 14132 Militaire Sous Napoléon 17e régiment d'infanterie de ligne, 4 mars 1813-24 avril 1813, (matricules 12601 à 14400
TOINOT Gabriel
Né le 03/06/1792 à Béhuard
- Père : TOINOT Pierre
Matricule 14876 Militaire Sous Napoléon 30e régiment d'infanterie de ligne, 20 février 1813-21 juillet 1814 (matricules 12 577 à 16 020).
Guerre 14-18
Durant cette guerre trois Morts seront à déplorer:
- BOUSSARD Julien- RETHORÉ Louis- DEROUET Louis Marie
Liste des Soldats de la Guerre 14-18
BERNARD Edmond
Né le 07/10/1889 à Béhuard
Père : BERNARD Jean
Mère : OLIVIER Léonie
BERTRAND Mathurin

Né le 22/05/1871 à Béhuard
Père : BERTRAND Mathurin
Mère : HASLIN Marie
BOUSSARD Augustin
Né le 25/04/1870 à Béhuard
Père : BOUSSARD Augustin
Mère : RICHOU Caroline
BOUSSARD François
 Né le 12/02/1873 à Béhuard
Né le 12/02/1873 à Béhuard
Père : BOUSSARD Pierre
Mère :RETHORE Marie
BOUSSARD Joseph Paul
Né le 15/04/1879 à Béhuard
Père : BOUSSARD René
Mère : COLIN Rose
BOUSSARD Jules Emîle
 Né le 06/10/1894 à la Possonnière
Né le 06/10/1894 à la Possonnière
Père : BOUSSARD Jules
Mère : TESSIER Eugenie
Mort pour la France le 26/08/1916
BOUSSARD René Joseph
 Né le07/09/1877 à Béhuard
Né le07/09/1877 à Béhuard
Père : BOUSSARD René
Mère : COLIN Rose
CADY Alphonse Henri
 Né le 02/08/ 1880 à Béhuard
Né le 02/08/ 1880 à Béhuard
Père : CADY Charles
Mère :VASLIN Jacqueline Joséphine
CADY Charles Joseph
Né le 23/04/1872 à Béhuard
Père : CADY Charles
Mère :VASLIN Jacqueline Joséphine
CADY Joseph Paul
 Né le 07/02/1874 à Béhuard
Né le 07/02/1874 à Béhuard
Père : CADY Charles
Mère : VASLIN Jacqueline Joséphine
CADY Mary Henri
 Né le 11/09/1882 à Béhuard
Né le 11/09/1882 à Béhuard
Père : CADY Mary
Mère : POUZETTE Marie
CADY Pierre Charles
 Né le 28/05/ 1884 à Béhuard
Né le 28/05/ 1884 à Béhuard
Père : CADY Mary
Mère : POUZETTE Marie
COLIN Edouard
 Né le 23/01/1888 à Béhuard
Né le 23/01/1888 à Béhuard
Père : COLIN Edouard
Mère :ROBIN Jeanne
DEROUET Maurice
 Né 14/06/1891 à Béhuard
Né 14/06/1891 à Béhuard
Père : DEROUET René
Mère :BOUSSARD Marie louise
Mort pour la France le 09/11/1914 à Dunkerque
DORANGE François Joseph
 Né le 12/04/ 1871 à Béhuard
Né le 12/04/ 1871 à Béhuard
Père : DORANGE François
Mère : BARRAULT Anne
LARUE Henri Eugene
 Né le 13/03/ 1897 à Béhuard
Né le 13/03/ 1897 à Béhuard
Père : LARUE Jean Claude -Gendarme à Pied
Mère : LEDUC Irma Constance
LEFEUVRE Cyprien
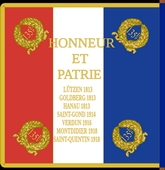 Né le 19/11/ 1873 à Béhuard
Né le 19/11/ 1873 à Béhuard
Père : LEFEUVRE Cyprien
Mère :GOUZIL Jeanne
MARAIS François

Né le 19/09/1880 àBéhuard
Père : MARAIS Jacques
Mère : RETHORE Jeanne
ORTION Pierre Joseph
 Né le 17/02/1879 à Béhuard
Né le 17/02/1879 à Béhuard
Père : ORTION Pierre
Mère :BENOIST Marie
POUZETTE Joseph Charles
 Né le 25/08/1868 à Béhuard
Né le 25/08/1868 à Béhuard
Père : POUZETTE Jacques
Mère :CADY Françoise
RETHORE Etienne Louis
 Né le 23/08/1877 à Béhuard
Né le 23/08/1877 à Béhuard
Père : RETHORE Etienne
Mère :LECLERC Marie Louise
RETHORE Henri René
 Né le 08/07/1869 à Béhuard
Né le 08/07/1869 à Béhuard
Père : RETHORE Henry
Mère : HERSANT Renée
RETHORE Pierre Louis
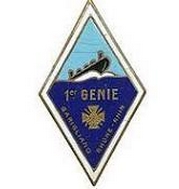 Né le 17/02/1881 à Béhuard
Né le 17/02/1881 à Béhuard
Père : RETHORE Etienne
Mère : LECLERC Marie Louise
Mort pour la France le 27/05/1918
RICHOU Auguste René
 Né le 04/04/1870 à Béhuard
Né le 04/04/1870 à Béhuard
Père : RICHOU Jean
Mère :COGNÉE Anne
RICHOU Jean
 Né le 04/04/1870 à Béhuard
Né le 04/04/1870 à Béhuard
Père : RICHOU Jean
Mère :COGNÉE Anne
RICHOU Marcel Auguste
Né le 22/01/1899 à Béhuard
Père : RICHOU Jean
Mère : DORANGE Andrée
RICHOU Pierre François
 Né le 05/01/1885 à Béhuard
Né le 05/01/1885 à Béhuard
Père : RICHOU Pierre
Mère :RETHORE Albertine
RICHOU Pierre Joseph
Né le 26/11/1870 à Béhuard
Père : RICHOU Pierre
Mère :BESNARD Joséphine
RICHOU René
 Né le 04/10/1899 à Béhuard
Né le 04/10/1899 à Béhuard
Père : RICHOU Pierre René
Mère :TAUNAY Joséphine
ROUSSEAU Benjamin
Né le 09/11/ 1887 à Béhuard
Père : ROUSSEAU Benjamin
Mère :DUVEAU Aline
ROUSSEAU Paul Jules
 Né le 14/06/1884 à Béhuard
Né le 14/06/1884 à Béhuard
Père : ROUSSEAU René- pêcheur
Mère :DUPRE Palmyre
TAUNAY Emîle
Né le 23/06/1893 à Béhuard
Père : TAUNAY Victor
Mère : RIVIERE Marie
TAUNAY Eugene Charles
 Né le 11/05/1877 à Béhuard
Né le 11/05/1877 à Béhuard
Père : TAUNAY Eugene
Mère : BOUSSARD Charlotte
TAUNAY René Charles
 Né le 14/10/1885 à Béhuard
Né le 14/10/1885 à Béhuard
Père TAUNAY Victor
Mère : BOUSSARD Joséphine
TAUNAY Victor Joseph
 Né le 03/11/1877 à Béhuard
Né le 03/11/1877 à Béhuard
Père TAUNAY Victor
Mère : BOUSSARD Joséphine
TOUCHAIS Alphonse

Né le 04/01/1872 à Béhuard
Père : TOUCHAIS Michel
Mère : ROUSSARD Marie Pauline
VOISINE Leon Eugene
 Né le 05/01/1893 à Béhuard
Né le 05/01/1893 à Béhuard
Père : VOISINE Stanislas
Mère : RETHORE Marie
Guerre 39-45
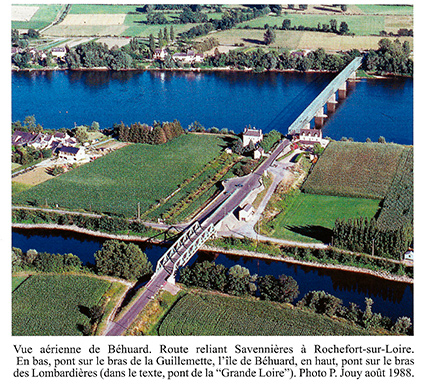
Contexte historique de la Guerre 39-45
En 1943, la Seconde Guerre mondiale arrive à un tournant. Des victoires sont remportées dans le Pacifique, en Afrique et en Atlantique ; les Allemands reculent également sur le front russe. Il est alors possible pour les Alliés de lancer « la grande croisade pour la démocratie et la liberté des peuples contre le nazisme ». Le terrain choisi est l'Ouest de la France.
Les Alliés savent tout du mur de l'Atlantique grâce au service de renseignements de la Résistance qui possède de nombreuses photos aériennes. Ils fabriquent également une formidable mise en scène, l'opération «Fortitude », destinée à persuader l'état-major allemand que le débarquement se fera dans le Pas-de-Calais.
L'objectif des Américains est de bombarder, bombarder, bombarder encore, pour anéantir les réseaux radars et les batteries allemandes, bombarder en Normandie pour rendre leurs mouvements difficîles, bombarder tout autour pour interdire, à leurs réserves, l'accès aux champs de bataille.
Le débarquement des Alliés du 6 juin 1944, malgré la tempête, le débarquement a bien eu lieu. Profitant d'une éclaircie, 5 143 navires protégés par 9 000 avions abordent les côtes normandes. 200 000 hommes prennent pied sur le sol français.
L'avancée dans les terres de Normandie va se montrer périlleuse et dévastatrice. Malgré le retard pris au départ dans le Pas-de-Calais, l'étau allemand réussit à se refermer pour barrer la route. Mais les Alliés sont déterminés et vont s'appuyer sur le soutien de l'aide apportée par les Forces Françaises de l'Intérieur : celles-ci en effet entravent, par leurs actions de résistance, les déplacements et les communications ennemis. La lutte ultime est engagée ; les dégâts seront monstrueux, le nombre de morts effrayant.
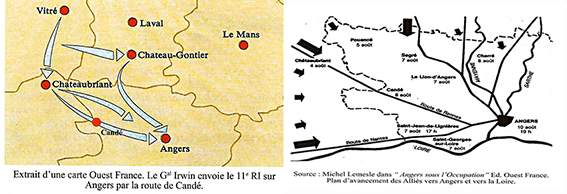
Après les semaines très difficîles qui ont suivi le débarquement, Avranches est libérée le 31 juillet. Le général Patton décide alors de foncer en direction de la Loire, Angers est en effet un point stratégique sur sa carte. Les blindés se lancent sur les routes, ne négligeant aucun itinéraire : depuis Vitré par Pouancé, Segré, Le Lion d'Angers, mais aussi depuis Châteaubriant par Candé, Le Louroux et Bécon-les-Granits. Dès le 7 août, une avant-garde campe à Saint-Jean-de-Linières. Dans la journée du 8 août, au prix d'un bref et violent combat, le pont ferroviaire de Pruniers, signalé par des résistants angevins, est franchi. D'autres unités s'avancent par la Meignanne et Avrillé où de cruels engagements se déroulent au long des journées des 8 et 9 août.
Nos communes ligériennes ne sont pas épargnées.
Dont Bouchemaine, Denée, Rochefort, la Possonnière et bien sûr, Béhuard Les habitants, du moins pour ceux qui le peuvent, suivent les évolutions du débarquement du 6 juin 1944 à la radio. Depuis trois mois, malgré la crainte des bombardements des forces aériennes qui protègent l'avancée des troupes, ils attendent avec impatience la libération de la Loire. Leurs espérances sont confortées par l'avancée des Alliés. Aucun d'eux n'aurait imaginer devoir vivre un cauchemar pour la reconquête de la paix et de la liberté .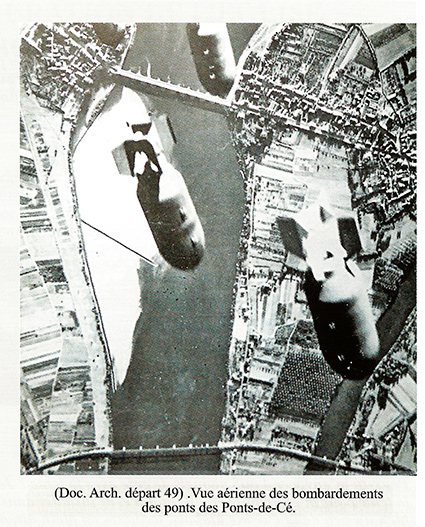
Les Alliés sont déterminés et disposent de moyens considérables. Au fur et à mesure de leur progression, ils mitraillent et bombardent nos gares et nos ponts, pour désorganiser complètement les transports d'hommes, d'armes et de marchandises, également pour rendre impossible tout retour, sur leurs arrières, de l'armée ennemie. Durant deux mois, les riverains vont subir les nombreux mitraillages et bombardements des uns et des autres. Sur la Loire, les ponts routiers de Montjean, Chalonnes-sur-Loire, des Lombardières, de Bouchemaine, le pont de chemin de fer de l'Alleud à La Possonnière, sautent les uns après les autres. La gare de La Possonnière et ses aiguillages sont également attaqués à de nombreuses reprises. La guerre semble partout faire des dégâts considérables : des morts, des blessés, des sinistrés, des matériels détruits, des terres agricoles ravagées par les explosions, etc... Les riverains hébétés se protègent comme ils peuvent, dans leur cave, dans un fossé, derrière un mur... Ils sont traumatisés
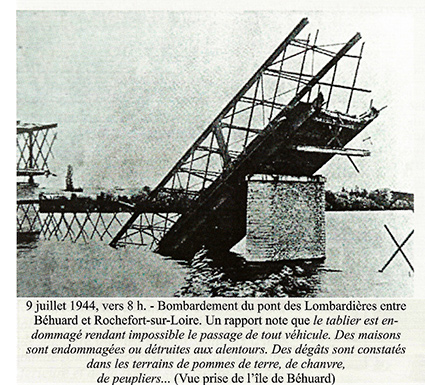
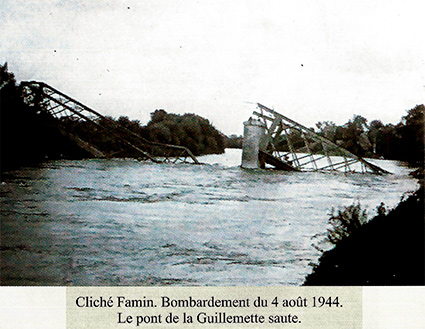 Les Allemands se replient au sud de la Loire. Furieux de s'être fait ainsi berner, également de devoir faire face à la Résistance plus forte et organisée qu'ils ne le pensaient, ceux-ci se montrent de plus en plus agressifs. Leur recul va s'accompagner de nombreuses exactions, destructions et prises d'otages. Dans leur retraite, ils coulent tous les bacs sur la Loire à la grenade et font sauter plusieurs ponts dont celui du Louet à Rochefort.
Les Allemands se replient au sud de la Loire. Furieux de s'être fait ainsi berner, également de devoir faire face à la Résistance plus forte et organisée qu'ils ne le pensaient, ceux-ci se montrent de plus en plus agressifs. Leur recul va s'accompagner de nombreuses exactions, destructions et prises d'otages. Dans leur retraite, ils coulent tous les bacs sur la Loire à la grenade et font sauter plusieurs ponts dont celui du Louet à Rochefort.
Dans l'île de Béhuard, les habitants sont tétanisés. Sirènes d'alerte et bombardements, maintes et maintes fois répétés, créent une atmosphère infernale ; les résidents sont hébétés et pensent à fuir pour sauver leur vie
A la fin d'août, les Allemands abandonnent la rive sud de la Loire... La guerre n'est pas, pour autant, terminée.
Mitraillages et bombardements, sur et autour de Béhuard, en juin-juillet 1944
- 23 juin, 3/5/8/12/22/29/31 juillet - gare, voies, trains à La Possonnière
- 8/9/16/19 juillet - 4 août - Attaque du pont de l'Alleud, soutenant la ligne Angers-Cholet.
- 9 août, pont suspendu de Bouchemaine
- 10 août, tirs de La Haie-Longue sur Angers.
- 12 août, tirs sur Denée et La Possonnière
- 13/14/15/16 août, bombardement autour du pont des Lombardières,
- 17 août, le canon gronde, on parle de l'évacuation des habitants de Béhuard. A 10 h. du soir, tirs sur le moulin de La Petite-Roche à Savennières.
- 21 août, on parle du départ des Allemands de Rochefort-sur-Loire.
Faits Divers
1832-Le choléra éclata avec violence le 1 juin
1939-Le facteur détournait les plis chargés destinés à M. le curé !
Des policiers, c'est-à-dire le commissaire divisionnaire Yvonnet, chef de la brigade de police mobîle d'Angers, et ses collaborateurs, les inspecteurs Jaheny et Baille, n'ont-ils pas, alors qu'il descendait de son vélo, devant la petite maison des P.T.T., sa tournée terminée, arrêté le facteur ? Que se passait-il donc ?
On le sut rapidement.
Depuis cinq ans , chargé de distribuer le courrier aux habitants de plusieurs communes, Mr V. G, qui a trente et un ans, détournait depuis le même temps des lettres chargées adressées au curé de Béhuard.
Ah ! oui, une sensationnelle histoire.
M. le curé de Béhuard dirige une maison d'orphelins, l'institut des Petits-Clercs. Il reçoit chaque jour ou presque chaque jour, de personnes charitables des lettres chargées, le plus souvent provenant d'Angers.
Or, en dépit de ses éloquents appels à la charité et des promesses formelles qui lui avaient été faites verbalement, M. le curé avait dû constater que le nombre des envois baissait avec une régularité inquiétante et inexpliquée. Il eut, un jour récent, l'occasion de constater que plusieurs lettres, à coup sûr expédiées, ne lui étaient pas arrivées.
Il se décida à faire part de ses ennuis au parquet d'Angers et M. Chevalier, juge d'instruction, ouvrit une enquête . C'est ainsi qu'une commission rogatoire fut confiée au commissaire divisionnaire Yvonnet.
Celui-ci eut tôt fait de dresser ses plans. S'étant mit en rapport avec certains des expéditeurs, il put suivre leurs envois dans leur court voyage, constater qu'ils arrivent bien jusqu'à la poste de Savennières, mais que certains d'entre eux, environ deux sur dix-sept, quotidiennement s'égaraient entre la maison postale et la cure de Béhuard..
Il ne lui restait évidemment plus qu'à interroger le facteur. Ce qu'il fit. Et il obtint les aveux. Cela durait réellement depuis cinq années.. Et c'est pourquoi hier, en descendant de bicyclette, il fut, sous les yeux d'une population vite alertée, Invité à monter dans la voiture de la brigade mobîle d'Angers. Il a été écroué..
Source:Journal la Dépêche Algérienne 4 juillet 1939
![]()